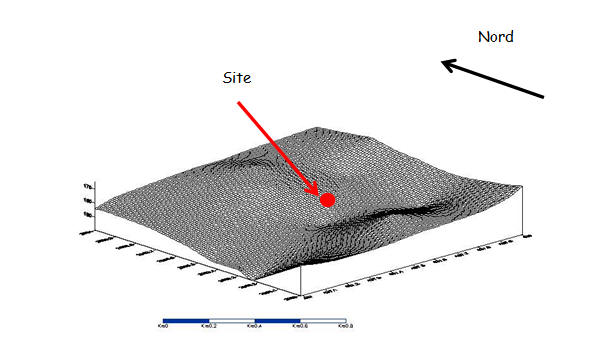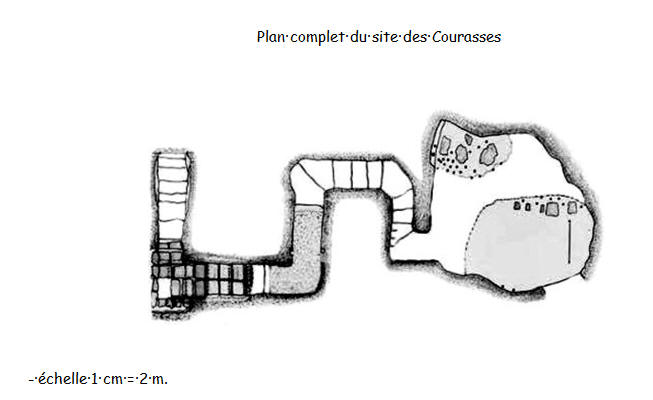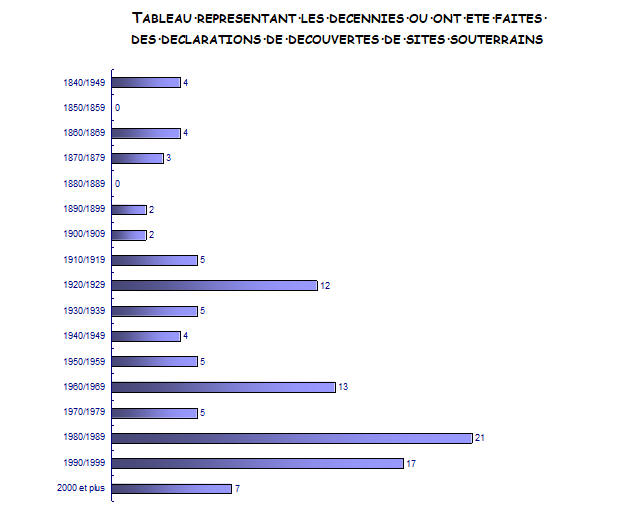AVERTISSEMENT
L’utilisation des données du
présent rapport est régie par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et
artistique. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées
pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation
collective (article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction du texte accompagné ou non de photographies,
carte ou schéma, n’est possible que dans le cadre de courte
citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de
l’ouvrage.
Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est
interdite en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juillet
1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration
et le public. Le non-respect de ces règles constitue un délit de
contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents
administratifs sont communiqués sous réserves des droits de
propriété littéraire et artistique. L’exercice du droit à la
communication (…) exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers,
la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins
commerciales les documents communiqués ».
Remerciements
Nous tenons à remercier M. Jean François Baratin, conservateur Régional
de l’Archéologie, ainsi que Mmes Véronique Dujardin et Nicole Lambert
conservatrices départementales de l’Archéologie, pour nous avoir
autorisé et renouvelé au cours de ces 5 années leur confiance pour cette
opération de recherche.
Nous adressons également nos remerciements :
-- à Monsieur
Serge Avrilleau, chercheur bénévole local, qui nous a fait découvrir de
nombreux sites souterrains surtout sur le département de la Dordogne.
-- aux services de la carte archéologiques du SRA de
Poitiers qui, par l’intermédiaire de Mmes Mazière et Redien-Laire et M.
Souvenot, nous ont facilité l’exploitation des fichiers et documents
existants sur certains de ces sites.
-- à la Société Archéologique et Historique de la
Charente qui nous a donné la possibilité d’exploiter leur fond
bibliographique.
-- à Madame Imma Carrion, responsable scientifique de
la fouille des Chatelliers à Embourie, qui en acceptant notre
participation sur sa fouille, a répondu à nos interrogations.
-- à Madame Fabienne Chiron et Monsieur Alain
Champagne, archéologues qui, par leurs conseils et aides nous ont fait
profiter de leurs expériences.
-- à Monsieur Serge Desthomas, géologue, qui
patiemment a su nous expliquer les différents contextes géologiques et
nous faire bénéficier de sa connaissance régionale.
-- aux nombreux chercheurs de la région
Poitou-Charentes qui ont toujours apporté des éléments indispensables à
nos travaux par leurs critiques et leurs précieux conseils.
-- aux municipalités des communes concernées qui nous
ont toujours fourni des renseignements et éléments utiles et nécessaires
à ces recherches.
-- aux nombreux propriétaires qui nous ont toujours
donné l'autorisation de pénétrer sur leur terres pour faciliter la
prospection de ces sites.
-- aux nombreuses personnes que nous avons pu
rencontrer au cours de nos pérégrinations dans cette région et nous ont,
pour la grande majorité d’entre eux, fourni les renseignements utiles
quant à la découverte de ces sites.
-- aux agriculteurs qui, après avoir saisi
l’intérêt que représente pour l’archéologie certains de ces vestiges,
ont accepté de modifier une partie de leurs exploitations pour ne point
les mettre en péril.
-- à Alice , mon épouse, qui m’a beaucoup aidé pendant
cette recherche, sur le terrain comme à la maison.
Merci à tous
Avant
Propos
Ce bilan scientifique est le résultat d’une recherche par prospection
thématique et s’inscrit dans le nouveau programme H20
"espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques
gallo-romaine, médiévale et moderne", défini par le Conseil Supérieur de
la Recherche Archéologique en 1997. Il devrait permettre d’amplifier
notre connaissance sur ces cavités aménagées, d’appréhender les
relations entre ces creusements et les habitats de surface, l’espace
rural qui s’y rattache et d’asseoir des référentiels de datation.
L’approche de cette opération a été développée en suivant les schémas
directeurs suivants ;
-- Choix d‘un secteur géographique général.
-- Prospection pédestre thématique en fonction :
de la géologie, la géomorphologie, la couverture végétale, la toponymie,
les indices révélateurs, etc.
-- Dans certains cas, dégagement des accès.
-- Exploration des sites pour en saisir le
contexte interne, ainsi que le repérage, le relevé et la protection du
mobilier inventorié.
-- Topographie et photographie des sites pour en
appréhender l’architecture, permettre un classement rationnel et en
dégager des hypothèses de contexte.
-- Étude spatiale et diachronique des
"creusements anthropiques souterrains" afin de pouvoir les intégrer à la
carte palétnogéographique de la Charente.
Il a semblé nécessaire d’associer à cette recherche une réflexion sur
les usages des "silos à grains". L’anthropisation de ces "fosses"
lorsqu’elles sont concomitantes au contexte souterrain est soit
chronologiquement antérieure, soit directement liée aux creusements des
souterrains ou aux aménagements des abris troglodytiques. A ce jour
aucun élément ne nous permet de les situer chronologiquement
postérieures à ces divers aménagements.
Plan de ce Document Final de Synthèse
Introduction,
Chapitre I
-- Bilan des connaissances scientifiques,
-- Présentation du secteur,
-- Contexte géologique,
-- Contexte hydrographique,
-- Cadre géographique,
-- Cadre historique.
Chapitre II
--
Contexte général,
-- Les souterrains,
-- Les silos à grains,
-- Analyse de la répartition des sites,
-- Géomorphologie d’un échantillonnage de sites,
-- Contexte du site de Baloge, commune de Dirac
(Charente)
-- Contexte du site de la Grande Crête, commune de
Edon (Charente)
-- Contexte du site de Chément, commune de Garat
(Charente)
-- Contexte du site de Fontignoux, commune de
Villebois-Lavalette (Charente)
-- Contexte du site des Courasses, commune de Dignac
(Charente)
Chapitre III
-- Le mobilier.
Chapitre IV
-- Problématiques,
-- Nouvelles perspectives de recherches.
Chapitre V
-- Conclusion,
-- Synthèse,
Chapitre VI
-- Sources
-- Bibliographie – Références Régionales,
-- Synthèse de bibliographie,
-- Logiciels utilisés.
-- Notes de références.
Introduction
Depuis longtemps notre attention avait été attirée par les souterrains
qui occupent un certain espace dans le département de la Charente. La
consultation des bibliographies régionales sur ce sujet, nous amena à
remarquer que depuis 130 ans les déclarations de découverte de ces
sites, bien que nombreuses
étaient ténues.
La Dordogne et la Haute Vienne, départements voisins du notre,
présentent un inventaire beaucoup plus structuré sur ces sites et ce
particulièrement dû au travail de Serge Avrilleau
pour le premier et Serge Gadypour le second.
Pour pouvoir aligner notre département sur ses voisins, nous avons
effectué pendant 5 ans une prospection verticale et horizontale de ces
structures. Pour nous permettre d’avoir une approche plus complète, nous
avons volontairement pris un secteur étroit et proche des deux
départements précités, qui en plus d’une proximité géographique et
historique, présente sensiblement les mêmes contextes géologiques.
Au cours de nos premières prospections, nous nous sommes très vite
rendus compte que les souterrains occupaient une place importante dans
l’imaginaire humain et faisaient l’objet de toutes sortes
d’élucubrations, phantasmes, mystère et convoitise. Nous avons dû très
vite adapter nos prospections aux relations humaines avec les
autochtones. La grande majorité de ces sites se trouve en zone rurale
comme nous le verrons plus loin, l’élément essentiel de notre démarche
prospective et donc de nos découvertes, a été une approche
"diplomatique" auprès des agriculteurs ou propriétaires terriens.
Ces démarches se sont avérées fructueuses puisque en 5 ans, 135 sites
ont été inventoriés dont 56 ont été topographiés. Ces recherches nous
permettent à ce jour de ne pas avoir une interprétation hâtive sur ces
structures mais une vue qui, bien qu’elle soit fragmentaire, permet de
dégager un cadre générique de ces creusements dans les régions Est et
Sud-Est de la Charente, régions où se sont portées nos recherches.
Chapitre I -
Bilan des connaissances Scientifiques
Sur le plan national :
M. Broens
pense que les souterrains ont été édifiés au Moyen Age pour une
utilisation clandestine liée à des survivances païennes et des croyances
non orthodoxes, lucifériennes, pseudo cathares et/ou autres. Il ne
semble pas envisageable de lier l’usage initial de ces structures
souterraines à la pratique de croyance clandestine. En effet :
P. Piboulepense que le site de Dénezé sous Douédans le Maine et Loir, qui effectivement semble correspondre à la
destination décrite par Broens, semble présenter dans l’état actuel
des découvertes, un cas unique en France.
Le creusement de telles
structures souterraines demande un très gros travail. Or pour
pouvoir donner un caractère clandestin à ces structures, il paraît
peu probable d’entreprendre de tels travaux clandestinement.
Aussi, sans vouloir contester les affirmations de M. Broens, les
motivations premières à l’édification de ces sites restent hypothétiques
et certains chercheurs peuvent être abusés par des aménagements
secondaires exécutés postérieurement au creusement initial.
Le C.I.R.A.C.qui devient en 1975 la S.F.E.S.,
possède un fonds important de documentation sur les sites souterrains
aussi bien en France qu'a l'étranger. Cette société en publiant un
bulletin trimestriel international a considérable contribué à
l'évolution de la subterranologie.
Claude Lorenz
en 1973, dans un essai de classification détermine de façon scientifique
les différentes catégories de creusements anthropiques. Son étude sur
les composants architecturaux de ces sites, lui permet d’envisager une
vision défensive de ces structures. Néanmoins il ne néglige pas de voir
également dans l’édification de ces structures souterraines une volonté
liée à un besoin culturel.
De 1855 à 1865, Touze de Longuemar
par une approche des structures architecturales de certains
souterrains étudiées dans l’ancien Poitou, démontrait une volonté
défensive et une recherche intentionnelle sécuritaire dans la confection
de ces derniers.
A la fin du 19éme et au début du 20éme siècle, T. de Rochebrune,
A. Favraud,
Dr Henri Martin,
A. Guérin-Boutaud,
Mercier,
G. Chauvet,
A. Masfrand,
H. Laffite,
font des descriptions précises des souterrains du département. Aucun ne
les situe dans un contexte et lorsqu’elles sont avancées les hypothèses
de datation sont imprécises.
Patrick Piboule
présente une étude de 33 souterrains de la région de Châtellerault. Ce
travail précis lui a permis de dégager sur ces sites, les
fonctionnalités suivantes :
--
40% de sites
sont à défenses passives,
-- 45% de sites sont des défenses stratégiques,
-- 10% de sites sont à usages culturels,
-- 05%.de sites sont à usages divers.
Un référentiel de datation
sera établi sur la fouille du souterrain de la Maurandie, commune de
Montgamè (Vienne).
Serge Avrilleaudans ses trois ouvrages consacrés aux "Cluzeaux et Souterrains du
Périgord" présente environ 500 souterrains qu’il a répertoriés,
topographiés et étudiés sur le département de la Dordogne. Il dégage
comme fonction initiale de ces structures une fonction défensive. Cet
énorme travail lui permet de dégager des idées génériques de ces sites
qu’il classifient en grande majorité de "Souterrains-Refuges". Hélas
par l’absence de fouille programmée, aucun référenciel de datation
n’existe dans ses ouvrages.
Pour déterminer le contexte attaché aux creusements anthropiques nous
avons délimité dans la région Est de la Charente les secteurs suivants :
Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette, communes de :
-- Blanzaguet – 2 sites,
--
Bouex – 1 site,
--
Chadurie – 3 sites,
--
Charmant – 1 site,
--
Combiers – 1 site,
--
Dignac – 1 site,
--
Dirac – 5 sites,
--
Edon – 3 sites,
--
Fouquebrune - 3 sites,
--
Garat – 3 sites,
--
Gardes le Pontaroux - 1 site,
--
Juillaguet – 1 site,
--
Magnac sur Touvre – 2 sites,
--
Sers – 6 sites,
--
Soyaux – 1 site,
--
Villebois-Lavalette - 2 sites,
--
Voeuil et Giget – 2 sites,
--
Voulgezac – 2 sites,
--
Vouzan – 1 site.
plus quelques sites hors secteur diversifiés dans le département
sur les communes de:
--
Aubeterre sur Dronne - 2 sites,
--
Bunzac – 1 site,
--
Criteuil la Magdeleine – 2 sites,
--
Echallat – 2 sites,
--
Gensac la Pallue – 1 site,
--
Juignac – 1 site,
--
Montignac le Coq – 2 sites,
--
Moutiers sur Böeme – 2 sites,
--
Saint Amand de Montmoreau - 2 sites,
--
Puymoyen – 1 site,
--
Souffrignac – 1 site.
Contexte Géologique
Le secteur
des recherches
se situe sur des terrains sédimentaires de l’ère Secondaire avec :
--
sur environ 1/5 de sa surface,
au Nord-Nord/Est, les étages du Jurassique, les plus anciens.
--
le reste appartenant à
différents étages du Crétacé, plus récents.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail géologique de chaque
étage car les nombreuses variations de faciès, même au sein de chacun
d’eux, rendent le contexte de chaque site particulier et induit alors
une étude spécifique.
On peut néanmoins dire que ces calcaires ont les qualités
requises pour assurer la pérennité des ouvrages souterrains en
présentant une résistance suffisante dans la limite des moyens
d’extraction dont disposaient les autochtones à cette époque. De plus,
les formations du Tertiaire, continentales et détritiques qui recouvrent
certaines hauteurs de notre secteur de recherche amenèrent argiles,
sables et galets qui convenaient sans doute, à certaines de leurs
activités.
Des souterrains se situent également dans des formations calcaires
souvent dures et massives dans les « limites étanches »des boucliers dont la puissance peut atteindre 6 mètres.
Dans ces contextes, les hommes qui les ont édifiés ont profité de la
présence de boyaux karstiques pour aménager leurs sites.
Enfin on peut envisager que quelques ouvrages qui ne respectaient pas
les conditions géotechniques minimales se sont effondrés, leur structure
n’ayant pas résisté à l’érosion naturelle activée par des conditions
hydriques défavorables et dans les conditions actuelles de prospection,
ne sont pas repérables.
Carte géologique de la région Est de la Charente (Echelle 1/50000°)

Alluvions AL, Tertiaire EP, Santonien-Campanien
C5-C6, Coniacien,
C4, Turonien C3,Cénomanien C2, Jurassique
J9
Contexte
Hydrographique
Ces 10 vallées ont former les "artères" pour l’élaboration des sites que
nous allons présenter. Dans le graphique ci-après, on constate que 62%
des sites se trouvent à moins de 100 mètres de ces vallées.

Contexte Géomorphologique
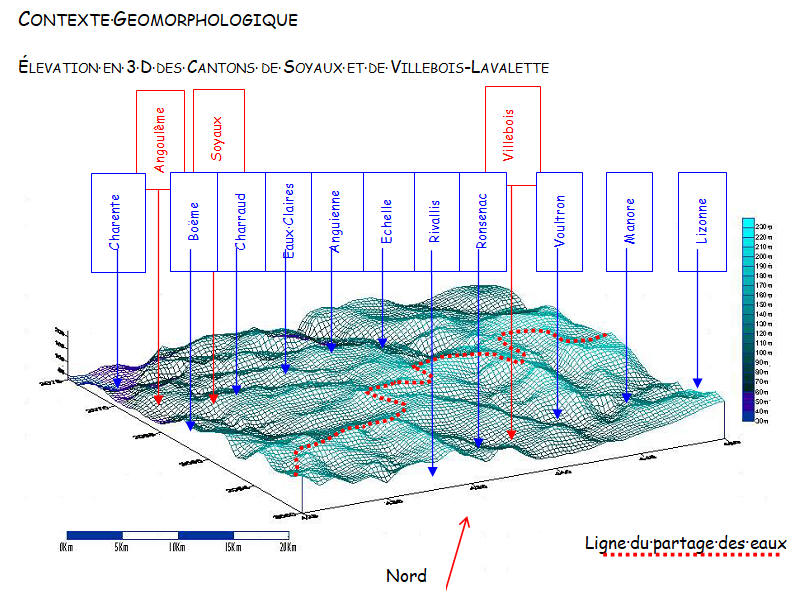
Cadre Géographique:
Pour pouvoir intégrer un secteur
des recherches dans un contexte gégraphique plus étandu et donc plus
générique, en plus des cantons de Soyaux et Villebois-Lavalette, nous
avons empiété vers le Nord-Est sur la canton de Montbrun, et vers le Sud
sur les cantons de Blanzac-Porcheresse, Aubeterre sur Dronne et La
Couronne.
La géomorphologie de cette région présente un aspect de plaines et bas
plateaux faiblement ondulés en légère déclive vers l’Ouest. Sans en
constituer un obstacle de relief, la ligne de partage des eaux (Charente
à l’Ouest et Garonne à l’Est) la coupe pratiquement en deux. Le système
des failles dû à l’orogenèse a formé des vallées profondes où le
calcaire affleure. De nombreuses grottes ou abris sous roches y existent
et donnent un caractère particulier à cette région.
La première "carte Géographique des Communes", laissent apparaît que
notre secteur de recherches est pratiquement séparé en deux par une zone
forestière représentant environ 50% de sa surface, partant de Montbron
et se terminant vers Moutiers sur Boëme. Ce massif forestier qui ne
pouvait qu’être plus important avant les grands défrichements du début
du premier millénaire,
est parfois large de plusieurs kilomètres dans son secteur Est,
pratiquement inexistant sur la commune de Fouquebrune et se termine en
pointe sur les hauteurs de Mouthiers.
A. Deborddans sa thèse souligne l’importance des forêts qui aurait
déterminé l’occupation du sol en constituant un "cloisonnement des
pays charentais". Ce cloisonnement qui, comme le confirme Aeberhardt,
aurait déterminé pour le département de la Charente un secteur de
passage Nord/Sud à l’Ouest et une zone de transit Est/Ouest à l’Est,
faisant de cette région un lieu de contact par laquelle se déplacera
progressivement la frontière linguistique entre français et dialectes
occitans.
Au Nord : (altitude de 60 à 164
m.)
Sur ce secteur de rupture importante, les niveaux Tertiaire, Cénomanien,
Turonien et Coniacien alternent le paysage. Les vallées moyennement à
peu larges, ont fait l’objet d’une urbanisation en aval. La forêt de
Bois Blanc et la Forêt de la Braconne sur un plateau karstique sont
jalonnées de pertes et de gouffres.
Au Sud : (altitude de 110à 197
m.)
Large plateau santonien très peu boisé est actuellement consacré à
l’agriculture avec quelques secteurs viticoles vers l’ouest. Cet horizon
est surmonté de quelques buttes tertiaires. On retiendra que dans ce
secteur le Campanien sur assise marneuse produit les premières sources
en amont des vallées. Cette zone de faibles contrastes de relief,
relativement peu peuplée, est une région de contact entre le Sud de la
région Poitou-Charentes et le Nord de l’Aquitaine.
A l’ Ouest : (altitude de 50 à
154 m. )
Ce paysage de plateaux et d’escarpements rocheux fut décrit par les
frères Tharaud (Jean et Jérôme)"…dès
qu’on quitte les vallées avec leurs ruisseaux d’eau claire, leurs sages
processions de peupliers, la joliesse d’en bas disparaît. Tout est
devenu sec et pierreux. Des genévriers, des arbres maigres, quelques
cyprès aussi. On pense à quelque chose de très sage, de très ordonné.
Une sorte de gravité mystique s’étend sur cette solitude peuplée de
pierres et de la végétation la plus pauvre. Ici c’est la Judée. Rien ne
donne mieux l’idée de la campagne de Jérusalem qu’une promenade sur ces
chaumes, en face d’Angoulême, un jour de plein été. Jamais je n’ai eu en
Orient l’étonnement de la lumière, je la connaissais déjà, je l’avais
vue ici".
Le plateau Santonien, partant de Moutiers sur Boëme et se terminant vers
l’Ouest en limite Charente/Dordogne vers Villebois, localement nommé "grenier
du Turonien", connaît l’intensification agricole.
A l’Est : (altitude de 88 à 240
m.)
Cette zone de polyculture diversifiée, dans laquelle l’élevage de bovins
domine, est pratiquement couverte de forêts très anciennes comme en
témoigne l’implantation de l’Abbaye Gramontaine à Rozet, commune de
Combiers vers l’an 1000
qui choisit la rigueur de la forêt du Clédou pour étendre son influence.
Les dépôts alluvionnaires continentaux du Tertiaire ont laissé en place
de nombreuses formations sablo-argileuses à galets qui affleurent sur le
haut des buttes.
Au mésolithique, ces espaces semblent avoir favorisé l’implantation
humaine.
Dans une époque plus moderne, cette zone a connu diverses activités :
extraction du minerai de fer, fabriques de charbon de bois, fabriques de
cercles de barriques.
En limite du département Charente/Dordogne, sous l’action des
précipitations des composants humiques et ferreux du paléosol, se sont
formées des dalles de grés silico-ferrugineuses. Ces dalles devenues
erratiques, piégées dans les failles et le fond des vallées, ont été
utilisées très tôt
par les hommes de cette région. Utilisation pragmatique comme polissoir
ou comme élément de construction servant à l’édification de dolmens et
menhirs, premiers ensembles architecturaux de cette région.
La deuxième carte "Cadre Géographique des Sites" montre nettement
l’influence des vallées dans le creusement des sites. Comme nous l’avons
vu plus haut dans le contexte géologique, ce niveau de calcaire dur,
compact et affleurant en bordure de ces dernières, offrait des
conditions favorables à une implantation humaine.
Cadre Géographique des Communes
Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette
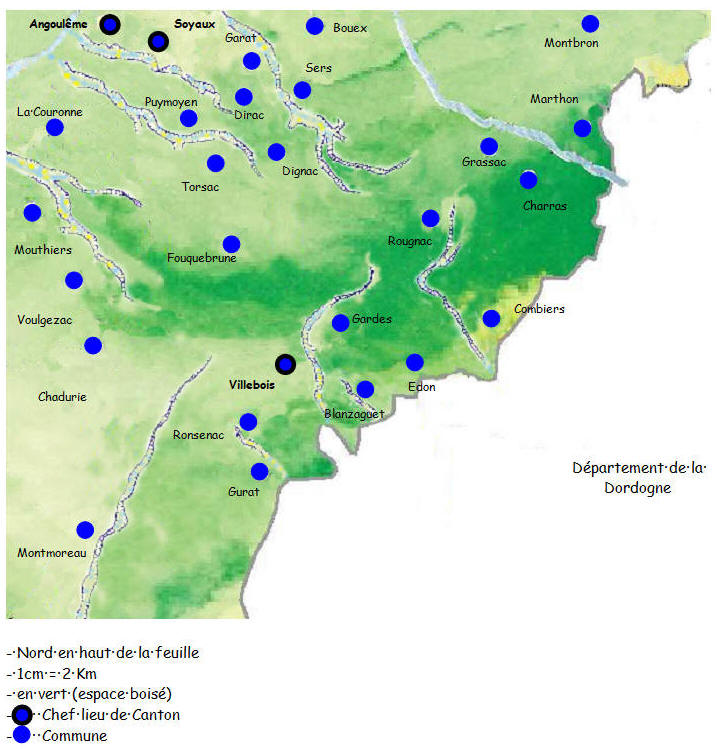
Cadre Géographique des sites
Cantons de Soyaux et de Villebois-Lavalette
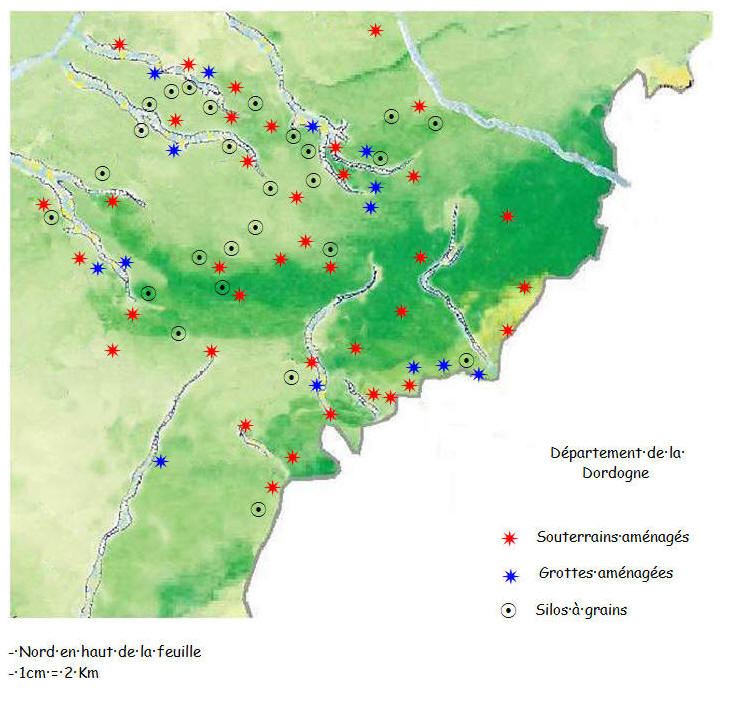
Cadre Historique
On ne peut pas négliger
le rôle de zone-frontièrede cette région à différentes périodes :
--
zone-frontière entre Pétrucores et Santons jusqu’au IVe
siècle,
--
limite de diocèse an 1100
--
zone-frontière entre France et Angleterre entre 1337et 1453.
--
ligne de démarcation en 1942,
--
limite actuelle Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin.
Epoque Gallo-Romaine :
La partie Est (Edon – Combiers – Rougnac – Grassac – Dignac), bien
qu’intégrée dans la région administrée par les Pétrucores, n’a révélé à
ce jour aucune trace de structure, ferme, monument gallo-romain. On peut
donc penser que sa topographie accidentée et boisée présentait un
handicap à l’occupation romaine. Néanmoins sur ce secteur, la toponymie
révèle le lieu dit "La Chaussade" où A. F. Lièvre
semble y voir la voie romaine Périgueux-Saintes. Une prospection affinée
dans ce secteur, n’a pas permis de conforter cette hypothèse. Cependant
rive gauche de la Lizonne sur le département de la Dordogne se trouvent
des blocs calcaires fréquemment utilisés en lieu de passage de gué, qui
demanderaient identification.
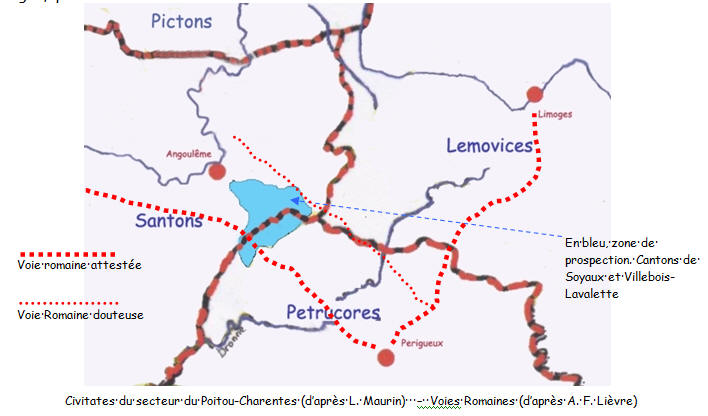
La partie Ouest (Soyaux - Dirac - Puymoyen - Sers - Bouëx - Vouzan)
présente un maillage relativement important d’occupation romaine mais
cette occupation ne semble pas dépasser vers l’Est les communes de Sers
au Nord et Dirac-Torsac au Sud. Cette occupation semblerait due à des
communications avec l’ancienne Icuslisma.
La partie Sud (Fouquebrune – Torsac – Villebois – Ronsenac) présente
également un maillage d’occupation important mais cela se limite à l’axe
de la voie romaine "Périgueux-Saintes"
Haut Moyen Age :
Si l’invasion sarrasine du début du VIIIe siècle semble être
passée dans sa progression vers le nord par l’Ouest de la Charente
(Saintes), le retour difficile vers le Sud des cavaliers de Abd Al
Rahman (732), se fera par une progression vers l’Est. On peut penser que
cette zone recevra des contrecoups de cette retraite
En 863 et 892, les incursions rapides (raids) des hordes scandinaves
d’Angoulême vers Périgueux auraient pu passer par cette zone,
contribuant ainsi à créer un climat insécuritaire.
En 877, le comté d’Angoulême est définitivement constitué.
La Province d’Angoumois englobe entièrement notre secteur de recherches.
Moyen Age :
Vers l’An 1000, la région comporte deux zones judiciaires (vigueries) :
--
901-902, juridiction de Vouzan.
--
En 1020, juridiction de la Rochebeaucourt (Edon, Combiers, Hautefaye,
Rougnac).
--
En 1050, le château de Villebois a déjà existence et son lignage
s’apparente au comte d’Angoulême.
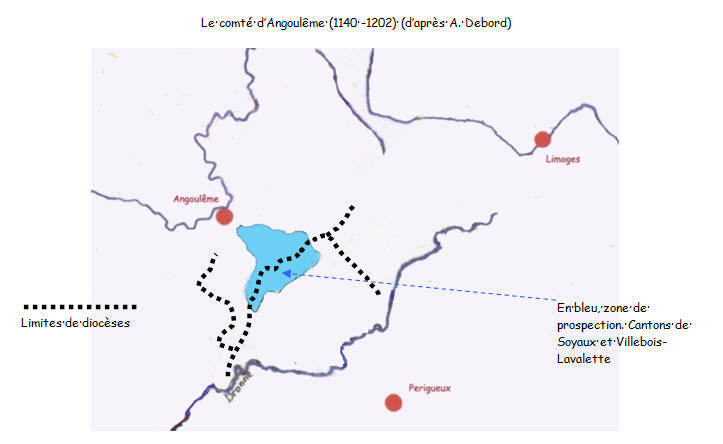
Sur la commune de Edon, au lieu-dit Hautefaye, il a été signalé des
fossés semi-circulaires. Debord
y situe avant le XIIIe une motte féodale. Cette motte repérée
par prospection aérienne en 1959, a été bouleversée en 1965 par
l’aménagement d’une plate-forme agricole (hangar et aire de
stationnement agricole). Nous avons rencontré le propriétaire qui se
souvient des fosses de 4 m. de large et 3 m. de profondeur qui ont été
entièrement comblées par l’arasement de la butte. Ce site de 500 mètres
sur 800 formait un quadrilatère d’environ 40 hectares. J. H. Michon dans
la statistique monumentale de la Charente, signale une châtellenie près
de La Rochebeaucourt, prénommée Hautefaye.
Il pourrait s’agir de ce château aujourd’hui disparu. De cette butte, la
vue est immense puisque l’on voit au Nord : la Rochefoucauld, à l’Est :
Piégut en Dordogne, au Sud : les buttes de Villebois et Montmoreau et à
l’Ouest : Angoulême. Nous ne pouvons que signaler l’intérêt stratégique
que pouvait apporter une telle position.
En 1308, le comté d’Angoulême est réuni au domaine royal.
Ce qui est convenu d’appeler la guerre de Cent Ans (1337 et 1453) sera
une période de guérillas. Hormis les raids du comte de Derby
vers 1348, notre secteur semble relativement calme avant le désastre de
Poitiers (1356).
En 1360 une alternance de conquêtes et reconquêtes faites d’expéditions
locales et de chevauchées épisodiques par des mercenaires en bande à
travers cette région, créent une insécurité permanente et une mise en
défense active est organisée avec la participation de la population.
Monique Bourin et Robert Durant dans leur ouvrage "Vivre au Moyen Age"
parlent de " solidarité défensive". Vers 1371, notre secteur
retrouvera une période plus calme avec la reconquête de la province par
le connétable Du Guesclin.
Note : Il est à
signaler que cette zone, actuelle limite de la région Poitou-Charentes
et Aquitaine a été en 1940 "frontière" entre France libre et France
occupée, avec le passage de la ligne de démarcation qui longeait les
limites nord du canton de Villebois-Lavalette.
Chapitre II -
Contexte général
Les creusements Anthropiques
Comme nous l’avons vu dans la partie relative au contexte géologique,
la région est répartie en deux zones; Jurassique ancien au Nord et
Crétacé supérieur au Sud. Cette différenciation géologique a fortement
influé sur les creusements anthropiques de notre secteur.
En effet au Jurassique le retrait progressif de la mer durant le
secondaire, a laissé en place une roche qui se présente en bancs
régulièrement stratifiés présentant des alternances de calcaire marneux
dur, à texture iso-grenue et fine, d’épaisseur décimétrique et des
niveaux marneux centimétriques. La puissance du Jurassique dans la
région est d’environ 500 mètres.
Dans cette structure stratigraphique, les phénomènes de gélifraction
ont fortement fracturé le niveau supérieur et ont laissé en place un
enchevêtrement de plaquettes désorganisé qui ont une propension à se
déliter. Ce niveau ne permet donc pas un creusement aisé des cavités
souterraines. En effet toute cavité creusée dans ce contexte se délite
très rapidement par l’effet de l'hétérogénéité de l’ensemble et de la
non altérabilité des couches marneuses. De ce fait toute cavité en plus
de ne pas permettre une régularité des parois et par conséquence des
aménagements minutieux qui en découlent,
ne conforte pas cette structure dans le temps.
Les quelques sites inventoriés dans ce secteur,
présentent tous une altération des parois qui ne permet point d’avoir
une vue du site dans son creusement initial. Il est même parfois
difficile d'en saisir le contexte général.
Au Crétacé supérieur le brusque retrait de la mer a laissé en place une
puissance de calcaire de 45 à 160 m qui se présente en un banc homogène
où très peu de strates existent. Par effet physico-chimique, la
formation du bouclier supérieur a contribué à rendre les couches
inférieures de faible résistance aux creusements, contribuant ainsi à
offrir des conditions idéales à l’élaboration, l’utilisation et la
conservation des sites souterrains.
Les souterrains : bien qu’il soit basique, le contexte
géologique n’a pas été la condition majeure aux creusements des sites
souterrains. Ce qui veut dire que les creusements ont eu lieu aussi bien
dans le Jurassique que dans le Crétacé, seulement si, dans ce dernier,
les conditions de conservation sont très correctes, il n‘en est pas de
même dans les sites creusés dans le Jurassique.
Les silos : ce type particulier de structures doit, comme
il sera expliqué au chapitre "Silos à grains", répondre à des conditions
de creusement et d’usages particuliers. Dans ces conditions les étages
du Jurassique Nord-Charente ne correspondent nullement à ce type de
structure. Nous n’avons d’ailleurs aucune connaissance d’existence de
silos dans ces zones.
I - Les souterrains
Dans l’imaginaire collectif on aurait trop vite tendance à faire des
souterrains un réseau de communication entre châteaux, logis, églises ou
abbayes. On leur fait parcourir des centaines de mètres, voire des
kilomètres, passer sous des cours d’eau, grimper des collines, etc.
L’évidence est bien toute autre. Jamais très longs, seulement de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres,ces souterrains sont classifiés en archéologie comme "souterrains
aménagés" mais peuvent être considérés comme des "souterrain refuges"
dans la mesure où ils comportent les éléments suivants, plus ou moins
élaborés ;
une ou des entrées camouflées,
--
un ou plusieurs couloirs souvent de conception orthogonale,
--
un ou des systèmes de chicane pour se défendre et ralentir la
progression des indésirables,
--
des barrages, des trous de surveillance, des pièges,
--
des salles pour y être à l’abri et y stocker des vivres et des
biens,
-- des
aménagements constituant ainsi en règle générale un système de
défense passive.
Techniques de creusement des
souterrains :
Dans l’état actuel de nos recherches, deux techniques ressortent dans le
creusement et la conception des sites souterrains :
--
Réaménagement des cavités
naturelles.
--
Création d’une galerie dans le
sol.
Dans un cas comme dans l’autre, le travail entrepris est considérable,
il ne s’agit point de construire une habitation, mais d’élaborer sous
terre un contexte plus ou moins compliqué mais répondant toujours à des
besoins spécifiques à savoir : couloir(s) d’accès et salle(s). Ce
travail effectué à la pioche ou à la barre à mine devait se faire à
partir de la surface par une ouverture réduite (pour cette raison un
pourcentage élevé
de souterrains auront leur couloir d’entrée initial, creusé à ciel
ouvert et ensuite recouvert par des dalles. Cette technique avait
l’avantage de permettre une progression de creusement plus aisée de
l’extérieur vers l’intérieur par l’évacuation directe des matériaux vers
la surface).
Création d’une galerie dans le sol : en sous-sol le creusement du
ou des couloirs se faisait par la technique de sape et obligeait les
sapeurs à faire remonter à la surface les matériaux extraits. Pour la ou
les salles, un ou des puits verticaux étaient creusés. Au fond de ces
puits un travail horizontal permettait de créer une ou des salles. Par
ces conduits verticaux étaient remontés à la surface les matériaux
extraits. Une certaine technicité était nécessaire pour entreprendre de
tels travaux où il était fait appel à des mesures géométriques et (ou)
d’orientation en milieu souterrain, pour pouvoir à partir de plusieurs
creusements séparés, couloir(s) et salle(s), ne faire qu’un seul
ensemble.
Réaménagement des cavités naturelles : En bordure de falaise, le
caractère rupestre et microclimatique des cavités qui s'y trouvent, ont
offert de tout temps aux hommes des conditions favorables à
l’élaboration d'abri. Certains affouillements ayant accueillis des
occupations préhistoriques, seront réoccupés en toute logique pendant
des périodes plus récentes par des occupations troglodytiques.
Ce réemploi d'espace est d'autant plus logique qu'en plus des conditions
favorables précitées, le travail d'élargissement et d'aménagement des
parois et d'évacuation des déblais y étaient aisés.
Période de creusement et
d’utilisation des souterrains :
Sur le territoire actuel de la France, les premiers souterrains attestés
apparaissent en Bretagne
à la fin du Hallstatt, début de la Téne (vers 600 avant J. C.). Ils sont
souvent de forme rudimentaire (une seule salle et un seul conduit),
constituant des abris momentanés mais pas de véritables lieux de séjour.
Shealagh G. dans une étude sur les souterrains en Grande-Bretagne et en
Irlande,
les date également de cette époque, par contre il signale qu’en Ecosse
on en construisait au IIe siècle de notre ère
ainsi qu’au Ve et VIe. Il pense également
que dans certaines parties de ce pays ils étaient encore utilisés aux IXe
et Xe siècles.
C’est pendant la période médiévale que le développement des souterrains
se propage. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Leur conception
devient ingénieuse et complexe. Les quelques datations effectuées
indiquent 1100 (± 90)ans pour le site de la Maraudie (Vienne)
et 1170 (± 90)
pour Saint Pardoux le Neuf (Haute Vienne).
On pourrait envisager que les populations rurales aient pu vivre des
périodes de climat insécuritaire les appelant à envisager la conception
de ces sites souterrains, d’où une volonté d’en faire des "cachettes"
avec des défenses passives.
Dans notre région, si l’on accepte le rôle défensif de ces structures,
il semblerait que l’occupation romaine n’ait eu aucune influence sur
leur élaboration :
--
d’une part la "paix romaine" est une période sécuritaire,
--
d’autre part, les deux grandes voies "Rom-Périgueux"
et "Périgueux-Saintes"
passent respectivement au Nord et au Sud de notre secteur de recherche.
Pendant les périodes où notre secteur a connu dans un premier temps les
pénétrations scandinaves (raids d’Angoulême vers Périgueux en 863 et
892)
et ensuite dans un deuxième temps la période trouble de la guerre de
Cent Ans aux XIIIe et XIVe siècles, il est fort
probable que contrairement aux populations des villes qui, elles,
pouvaient faire preuve d’une grande solidarité défensive. Les
communautés rurales, face à ce climat insécuritaire furent amenées à
élaborer ces structures de défense passive plus isolées.
Néanmoins, nous ne nous engagerons pas à dire qu’il y ait une étroite
relation entre la cause de ces périodes insécuritaires et l’effet de ce
"besoin" impérieux de "refuge-souterrain". Il faut néanmoins constater
que cette volonté est commune dans toute l’Europe du Moyen Age
et que notre région ne semble pas déroger à cette règle.
Nous avons constaté que la période d’élaboration de ces structures
semble assez courte comme en témoigne une certaine uniformité dans leurs
architectures et par conséquence une certaine stéréotomie dans les
aménagements internes. Cette "norme" conceptuelle semblerait dans notre
région pouvoir s’associer avec nos régions limitrophes (Limousin et
Périgord) et donc en général se situer entre le Xe et le XIIIe
siècles.
Habitabilité d'une structure
souterraine.
Ce type de structure creusé sous terre, élaboré avec des moyens
rudimentaires avec plus ou moins de soins, jamais de très grande
dimensions (la moyenne de surface habitable est de 8 à 16 m²), humide,
basse de plafond (moyenne 1,55m.), sans eau, avec très peu d'apport
d'air frais, ne peuvent que représenter des abris précaires et
temporaires.
--
Abri précaire : Bien qu'efficace les défenses si elle sont repérés
de peuvent résister longtemps à un agresseur déterminée. De plus cet
abri se révèle être un véritable piège pour les occupants. Il est bien
évident qu'une fois repéré aucune fuite n'est possible.
--
Abri temporaire : Le surface "habitable" y est peu confortable et de
très moyenne dimensions Dans ces conditions ces abris ne pouvaient
présenter qu'un abri sécuritaire que pour une voire deux cellules
familiale (4 à 8 personnes) et sans animaux domestiques. Dans des
conditions d'inconfort évidentes, la période ne pouvait être que
relativement courte (de quelques minutes à quelques heures) mais
sûrement pas quelques jours.
Abandon des souterrains :
Nous n’avons aucune certitude que les souterrains creusés en fonction
d’un certain nombre de motivations édictées ci-dessus ont "servi". En
effet si le rôle préventif de ces structures est évident, leurs usages
le sont moins. Il paraît d’ailleurs très difficile de pouvoir construire
une hypothèse à ce sujet dans la mesure où aucune trace écrite ne
stipule tel fait et il semblerait très imprudent, même avec une fouille
des couches stratigraphiques de pouvoir attester que tel ou tel refuge
aurait subit un assaut quelconque.
Néanmoins force est de constater que ces sites ont été abandonnés,
détruits, comblés ou obstrués par des actions volontaires.
Leur destruction s'est effectuée de différentes façons :
--
par action naturelle :
comme le remplissage géologique des grottes et cavités naturelles, ce
remplissage est caractérisé par des éboulis de terre très fine dûs aux
infiltrations par les parties ouvertes supérieures. On remarque
également une très légère pellicule d’argile recouvrant uniformément le
sol et quelquefois un léger dépôt de calcite. Le délitement du plafond
et des parois, ainsi que les animaux troglophiles ont également
contribué à une partie du comblement.
--
par action anthropique :
par destruction des parois des salles,
démolition rendant le site inexploitable, par destruction des dalles de
couverture des couloirs d’accès,
par comblement des couloirs d’entrée initiaux
et par bouchage du couloir d’accès initial.
Il existe également quelques cas où ces sites ont été utilisés comme
dépotoirs
La volonté de comblement est évidente dans une très grande majorité de
ces sites. Nous avons constaté que dans une très grande proportion de
sites, des pierres assez grosses et/ou des remblais de natures diverses
sont répartis bien au-delà des secteurs où les auraient entraînés les
éboulis naturels. On trouve également des pierres étrangères aux roches
locales et toutes sortes de matériaux hétéroclites.
Note : Au XIIIe
siècle les inquisiteurs
pressés par le Pape, ordonnent de rechercher et détruire ces "clusellae".
II - Les silos à grains
La nature géologique du sol est prépondérante pour le creusement de ces
cavités qui ont toujours une forme de poire, d’œuf ou de bouteille et
sont appelées selon le terme générique « fosses ovoïdes». Bien qu’on en
ait trouvées dans des sols argileux, desséchés et durcis par du feu
en grande majorité elles se trouvent là où la présence du rocher
affleure, souvent sur un plan en déclive près d’une vallée et d’un point
d’eau. Leur présence est également courante à proximité des grottes et
des sites troglodytiques.
Leur existence est attestée dans toute l’Europe, avec une prédominance
pour le Moyen Orient et le Sud de l’Europe. Si l’origine de ces silos
reste indéterminée, leur présence sous terre est déjà citée par Varron
qui décrit dans un traité d’économie rurale ces "granaria speluncas" en
60 avant J. C. L’étude de l’habitat de l’Arriasse à Vic-le-Fesq (Gard)en situe sur son site et les datent de 700-625 avant J. C.
soit le début du premier Age de Fer. Citons également, les nombreux
silos d’Ensérune (Hérault) qui ont fourni aux fouilleurs une datation
voisine des Vle et Ve siècles avant notre Ere. On
en trouve également près des voies romaines,
des mottes féodales et des lieux de cultures agraires.
Certaines régions au climat sec ont, depuis l’Antiquité utilisé un
système d’ensilage aérien ou dans des jarres de terre cuite. L’humidité
de l’air semble avoir incité les agriculteurs de Europe occidentale à
utiliser plutôt l’ensilage souterrain. Dans notre région, si les silos
sont souvent associés à la proche périphérie des souterrains ou des
habitations troglodytiques, on en trouve également isolées en zone
rurale. Les silos sont présents dans tous les calcaires, rares dans les
marnes mais inconnus dans les sables ou les roches éruptives.
Le diamètre d’ouverture varie de 0,40 m à 0,60 m, la profondeur de
1,50 m à 2,20 m et la largeur intérieure de l’ordre de 1,00 m à 1,60 m.
Souvent un épaulement au col de l’ouverture permettait d’en assurer
l’étanchéité par un couvercle.
Lorsqu'ils sont groupés, il n’est pas rare qu’ils communiquent entre eux.
Le fond est concave ou plat. On peut constater que la forme ronde est
universelle.
Les silos à grains creusés dans le sol témoignent d’un mode de
conservation des céréales en atmosphère confinée, mode de stockage bien
connu par le passé et dans de multiples sociétés traditionnelles. Ces
techniques ont fait l’objet de nombreuses études
et expérimentations
qui en expliquent le fonctionnement : dans un milieu hermétiquement
clos, la céréale commence sa germination et dégage au niveau de ce
processus du gaz carbonique, gaz qui bloque la poursuite de la
croissance et neutralise les insectes, en rendant l’atmosphère anoxique.
Si le contenant n’est pas ouvert, le contenu peut se conserver plusieurs
années et garder toutes ses qualités germinatives et nutritives. Par
contre une fois ouverte, la structure doit être vidée et les grains
aérés sous peine de pourrissement rapide. Ce procédé est donc un système
de stockage de céréale à long terme et non une réserve où l’on viendrait
y puiser en fonction des besoins.
On trouve également des silos de petit diamètre qui pourraient être non
pas des lieux de stockage de grains pour répondre à l’économie vivrière
d’un groupe mais du stockage de grains pour des semences.
Outre l’avantage de la longue conservation, il y a lieu d’ajouter aux
silos souterrains le gros intérêt d’éviter les pillages, la convoitise
des seigneurs et avidité des collecteurs d’impôts. Le même problème est
applicable aux grains comme au sel au temps de la Gabelle. Olivier de
Lerre et Voltaire abondent dans ce sens. D’autre part l’ensilage
souterrain participe aussi à la régulation des famines comme des
excédents et peut-être aussi à la manipulation du cours financier des
céréales.
Technique de creusement des
silos :
Dans la région Est et Sud-Est de la Charente, la grande majorité des 58
silos à grains répertoriés ont leur structure entièrement taillée dans
le calcaire, dans les environnements suivants :
sur des affleurements rocheux ;
--
Silos de la Gélie à Edon.
--
Silos du bois de la Pue à Dirac.
--
Silo de la ferme de Joufferoux à Blanzaguet.
--
Silo de la Tranchade à Garat.
--
Silos des Courrases à Dignac.
dans des abris sous roche ;
--
Silos du Moulin de Baloge à Dirac.
--
Silos du château à Dirac.
--
Silo du Châtelard à Dirac.
--
Silos du Roc à Mouthiers.
dans des souterrains ;
--
Silos des Pendants à Vouzan.
--
Silos du Parc Bas à Sers.
--
Silos de la Source Bompard à Voeuil et Giget.
--
Silos du Moulin Nadaud à Sers.
Néanmoins les silos de la Trautran à Torsac
et de chez Nadaud à Dignac dérogent à cette règle. Ces deux silos
proches l’un de l’autre de 3 Km, de même facture présentent une
exception quant à leur conception à savoir d’avoir été creusés aux 2/3
dans la roche et au 1/3 construit. La similitude de ces deux silos
laisse penser qu’ils on été réalisés par le même groupe et dans une
période très proche. S’il s’agit là des seuls exemples de silos
construits connus dans le secteur de nos recherches, des silos également
de même facture, ont été repérés dans le midi de la France,
où Raynaud les date de l’époque romaine.
Période de creusement et
d’utilisation des silos :
Période Romaine : il semble probable que la romanisation a
apporté un changement des méthodes de stockage dans l’organisation
politique et économique de notre région. Durent apparaître une
spécialisation des cultures et d’autres phénomènes caractérisant
l’avancée romaine. L’évolution en masse des cultures nouvelles avec
principalement la plantation de la vigne, à laquelle fait écho
l’introduction des amphores vinaires et des dolias semble faire
apparaître que pendant cette période les méthodes de stockage en silos
aériens se soient restreintes voire abandonnées.
Période Post Romaine : la répartition des sites permet de penser
que la population rurale devait être sédentarisée dans des habitats
extrêmement précaires dans les alentours immédiats des vallées. Cette
période d’insécurité a conduit au développement du creusement des
souterrains. La confection de ces structures souterraines s’est souvent
accompagnée de creusement de silos internes.
Période Médiévale : Chapelot J. et Fossier R. pensent que ce mode
de stockage des céréales a été employé bien au-delà du premier
millénaire et même parfois jusqu’au XVIIe et XVIIIe
dans certaines régions françaises méridionales.
Ces cavités représentant des lieux de stockage de l’économie vivrière
d’un groupe, sont les seules parties dures restantes des structures
d’habitation et doivent êtres considérées comme des annexes de maison.
De toute évidence les communautés qui les utilisaient ne pouvaient être
que sédentarisées dans un habitat relativement proche, voire même
au-dessus du silo ou des silos.
Dans la partie Est/Sud-Est de la Charente, on trouve :
des silos isolés sur les communes de :
--
Dignac, 1 silo
--
Dirac, 8 silos
--
Edon, 2 silos
--
Garat, 2 silos
--
Pranzac, 1 silo
--
Sers, 7 silos
--
Villebois-Lavalette, 3 silos +
1 silo
des silos à l’intérieur des souterrains-refuges sur les communes de :
--
Chadurie, 1 souterrain avec 2
silos
--
Dirac, 1 souterrain avec 2
silos
--
Puymoyen, 1 souterrain avec 2
silos
--
Sers, 2 souterrains un avec 1
silo, un avec 6 silos
--
Villebois, 1 souterrain avec 3
silos
--
Vouzan, 1 souterrain avec 5
silos
des silos modifiés ou réutilisés par le creusement des
souterrains-refuges sur les communes de :
--
Charmant, 1 souterrain avec 3
silos
--
Dirac, 1 souterrains avec 9
silos
--
Garat, 1 souterrain avec 1
silo
--
Sers, 1 souterrain avec 6
silos
--
Sers, 1 silo anastomosée par
une carrière
--
Voulgezac, 1 souterrain avec 1
silo
Abandon des silos :
Dans ce type de structure, après une utilisation de conservation de
céréales, le silo une fois vidé de son contenu était nettoyé. Ce
nettoyage consistait à un grattage des parois où un début de germination
pouvait se faire. Ce grattage des parois, avait tendance tout en donnant
à la surface interne du silo un aspect de plus en plus lisse et régulier
de fait, à agrandir sa structure interne. Lorsque les silos étaient
voisins, ce "nettoyage" pouvait les faire communiquer accidentellement
entre eux par la partie où les parois étaient les plus proches. A ce
stade les silos devenaient inutilisables et étaient abandonnés comme par
exemple :
--
Silos du site de Bellevau à
Sers.
--
Silos du Parc Bas à
Sers.
--
Silos du Bois de la Pue à
Dirac.
--
Silos du site d’Argentine
(Dordogne).
--
Silos de la source Bompard à
Voeuil et Giget.
--
Silos du Roc à Mouthiers.
Dans de nombreux cas,
les chronologies de creusement silos/souterrains attestent une
antériorité à ces premiers. Si l’on retient comme date butoir
l’utilisation des souterrains vers la fin du XIIIe siècle, ont peut donc
penser que dans notre région l’usage et la fin d’utilisation des silos
sont antérieurs à cette période.
Note au sujet du terme silo et de
ses interprétations :
Une étude sur Varron (Marcus Térentius Varo) dans un traité Agronomique,
cite : — On voit dans Varron que ces divers procédés et surtout les
silos, étaient bien connus des Anciens qui serraient leur blé, les uns
dans des greniers élevés et bien aérés, les autres dans des souterrains
ou cryptes qu’ils appelaient "σετρουζ" [seïros ou seïrous] on en voyait
en Cappadoce et en Thrace. La conservation du blé se faisait, entre
autres procédés, en le renfermant dans des silos, ou fosses souterraines
disposées pour préserver le grain du contact de l’air, de l’humidité et
des attaques des insectes. On en couvrait le fond d’une couche de paille
et on empêchait l’accès de l’air et de l’humidité en les fermant
hermétiquement (tant que l’air n’y pénètre pas, il n’y a pas de
charançons).
[ triticum condi oportet in granaria sublimia quae perfientur vento
ab oxortu... Quidam granaria habent sud terris, speluncas quas vocant ut
in Cappadocia ac Thracia. alu in Hispania citeriore, puteos, ut in agra
Carthaginiensi et Oscensi Horum solum paleis subternunt, et curant ne
humor aut aër tangere possit nisi cùm promitue ad usum; quo enim
spiritus non pervenit ibi non oritur curculio…]. L’auteur ajoute «
dans des silos ainsi préparés, le blé pouvait être conservé jusqu’à 50
ans et le millet plus de 100 ans.
--
"σετρουζ" Traduction du
Grec d’après le Dictionnaire Grec-Français, Le Bailly :
--
σετρουζ, συ, (δ), "Cavité dans le sol ou récipient souterrain
pour conserver le bled
--
Silo. Sophocle. fr. 276. Euripide. f 827. Démosthène. 100,
29, cf. 135, 27. Varron. de r. r.
25,75
--
Trappe. Euripide. l. c. Anthologie palatine. 26 app. 25.
Varron. de r. r. 1, 57. (hébreu ou phén. ?).
--
Traduction du latin d’après le
Dictionarium Universale Latino Gallicum, Paris, 1784.
--
Siros, i.m. Varron. "Foffe profonde d’préparée pour y
mettre du bled, & l’y conferver fous terre, dont l’ufage
eft en quelque pays où l’on féme par deffus".
--
Syrus, i. m. Quintilien. 25 Curtius. 29 "Lieu fouterrain,
où l’on ferre les grains".
d’après le Dictionnaire Robert de
la langue française.
--
Silo est emprunté (1685) à l’espagnol silo (lui-même emprunté
vers 1050 par l’intermédiaire du latin didactique Sirus au grec Siros).
--
Silo est employé au sens de cachot souterrain dans l’espagnol
et le grec du XIIIe siècle.
--
Sil en provençal est employé au Moyen Âge (1280). Peu utilisé
en France avant le XIXe siècle.
--
Silo désigne une punition consistant à enfermer un prisonnier
dans un trou dans le sol en Afrique.
Analyse des Contextes des sites du secteur
des recherches.
Aucune règle ne peut être appliquée quant au choix du lieu de
creusement, si ce n’est que la nature géologique du sous-sol étant
prépondérante à l’édification de tels sites, les communautés qui ont
élaboré ces structures ont par obligation choisi un environnement
calcaire.
Le graphique ci-dessous détermine une forte proportion d’implantation
des sites dans le Turonien supérieur. Ce niveau géologique affleurant,
prédominant dans ce secteur, offrait les caractéristiques essentielles
aux conditions vivrières d’un groupe (occupations antérieures,
résistance de la roche, hydrologie, vallée, protection naturelle). De
plus les bonnes conditions de conservation de cet étage permettent des
prospections et donc des repérages plus aisés que dans les niveaux
inférieurs ou supérieurs.
Il est à signaler que de nombreuses exploitations d’extraction de pierre
ont détruit totalement ou partiellement de nombreux sites.
 75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.
75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.
Dans les zones rurales ils peuvent se trouver soit en situation isolée
sans repérages au milieu d’une parcelle de terre ou d’un bois actuel,
soit et cela dans leurs plus fortes proportions à proximité des vallées.
Dans des zones urbaines en agglomérations actuelles. Dans ce cas, ils se
situent le plus souvent dans la partie la plus ancienne de la commune,
souvent à proximité d’un château ou d’une église.
Il n’est pas rare d’y trouver concomitant : grottes et/ou abris sous
roche, aménagements plus ou moins complexes d’aménagements
troglodytiques.

Dans le graphique ci-dessus, 64% des sites sont sans silos, alors que
36% comportent soit des silos intérieurs ou extérieurs. Dans les 36% de
sites avec silos, seulement 12% sont des silos creusés dans des abris
troglodytiques, ce qui veut dire qu’une forte proportion de silos
accompagne très souvent des souterrains. Si 27% des sites ont été créés
à partir de cavités naturelles déjà existantes, 73% ont été créés à
"cru" dans un géol vierge.
La majorité de ces sites (46%) se trouve en bordure de falaise, ce qui
confirme que le niveau Turonien, seul étage géologique à avoir formé
dans ce secteur des affleurants calcaires en bordure des vallées a été
prédominant quant au choix pour le creusement de ces structures.
Néanmoins 29% des sites se trouvent sur des collines et 25% en plaine.

Les aménagements intérieurs des sites souterrains ne dérogent pas aux
schémas classiques de ce type de structure. Il est donc logique d’y
trouver une forte proportion de salles (86%) et l’on peut envisager que
les 14% manquants sont le fait que des comblements ou des effondrements
ne permettent pas actuellement d’appréhender dans leur entité ces
structures. Si tel était le cas nous ne devrions pas être très loin des
100%
Le faible pourcentage de site comportant des couloirs recouverts de
dalles en bâtière (18%), s’explique par le fait que ce type de
couverture n’est élaborée que dans les structures qui se situent
géomorphologiquement dans un contexte de butte-colline ou plaine (54%
des sites). La même remarque sera applicable aux puits d’extraction pour
lesquels on retrouve approximativement le même pourcentage (61%).
Si les silos à grains du fait de leur structure relativement simple
d’aménagement interne, ne seront pas évoqués dans ce chapitre, il faut
noter que 54% des sites souterrains comportent des "aménagements" de ce
type, soit à l’intérieur, soit dans les environs immédiats. Néanmoins le
repérage des silos à grains à l’extérieur des sites, sans sondage est
difficile du fait du faible diamètre de leur ouverture (de 0,40 à 0,60
m.). On peut donc envisager que le nombre de silos donné ci-dessous
devrait être supérieur à 54%.

Après leurs creusements initiaux, une première phase de réemploi a été
observée.
Si 46% des sites sont abandonnés, 54% sont réutilisés pour d’autres
fonctions. Le graphique ci-dessous, fait apparaître une disparité dans
leurs réemplois. Si l’on exclue une réutilisation cultuelle à 2%, il se
dégage une volonté de réutilisation utilitaire de ces structures
souterraines.
 Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce
cas elle ne porte plus que sur 21% des sites.
Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce
cas elle ne porte plus que sur 21% des sites.

Géomorphologie d’un échantillonnage de 5 sites
Il aurait été fastidieux
de présenter un par un les 56 sites répertoriés. Beaucoup de sites se
ressemblent et présentent les mêmes caractéristiques et/ou géologique,
géographique, géomorphologique et architecturale. Pour permettre d’avoir
une vue d’ensemble sur les sites de cette région, nous avons choisi
délibérément 5 sites.
Le choix de ces sites ne s’est pas fait au hasard, ils représentent
chacun une catégorie particulière tout en offrant un ensemble de
généralités. Pour ce faire notre choix s’est porté sur les sites
suivants :
-
Site du souterrain de Baloge à
Dirac. (réf SRA 016-16249)
-
Site de la Grande Crête à
Edon. (réf SRA N°003-16253)
-
Site du Souterrain de Chément
à Garat. (Réf SRA -0016-7838)
-
Site du souterrain de
Fontignoux à Villebois-Lavalette. (réf SRA N°005-16259)
-
Site du souterrain du
Courasses à Dignac. (Réf SRA -16 119 10 AH)
Dans les pages suivantes on trouvera les caractères particuliers de ces
5 sites.
1 -
Site de bas de falaise :
Site du souterrain Baloge à Dirac. (réf SRA 016-16249)

Présentation du contexte géomorphologique du site de Baloge
Ce site creusé dans le calcaire Turonien supérieur, se trouve sur le
versant Ouest de la vallée de l’Anguienne en bas d’une falaise haute de
26 m de hauteur. Son accès initial se faisait par le fond de la vallée.
Il comporte deux niveaux :
Au niveau supérieur un abri sous roche a été modifié et aménagé
en abri troglodytique, un élargissement de diaclase horizontale a
permis, par un escalier, de faire communiquer la partie supérieure du
site à sa partie inférieure. Il est à noter qu’entre ces deux parties
une diaclase verticale à été réaménagée pour servir de piège.
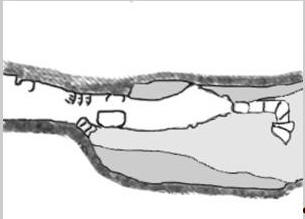
Un niveau inférieur où après l’escalier et un couloir, une salle
a été creusée. Au fond de cette salle subsiste le puits
d‘extraction des matériaux.
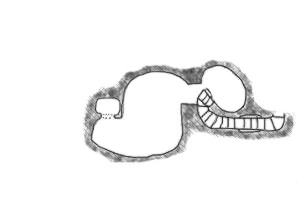
Ces principales caractéristiques en sont :
--
aménagements des parois dans l’abri sous roche,
--
couloir de 5.5 m. de longueur,
--
escalier de 18 marches,
--
piège,
--
puits d’extraction de matériaux,
--
salle de 4 m. sur 3m.
Note : On trouve également sur ce site deux silos à grains partiellement
détruits par l’aménagement du site.
2 - Site de Falaise : Site
de la Grande Crête à Edon. (réf SRA N°003-16253)

Présentation
du contexte géomorphologique du site de la Grande Crête
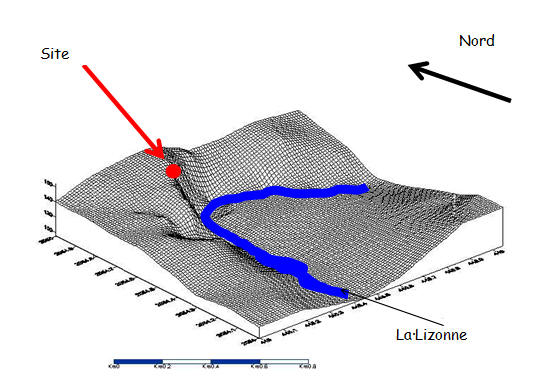
Ce site creusé dans le calcaire Turonien supérieur, se trouve sur le
versant Ouest de la vallée de la Lizonne, qu’il domine de 65 m. Son
accès initial se faisait par le haut de la vallée.
Il s’étale sur un même niveau, mais comporte deux parties distinctes :
--
la partie Ouest,
--
la partie Est.
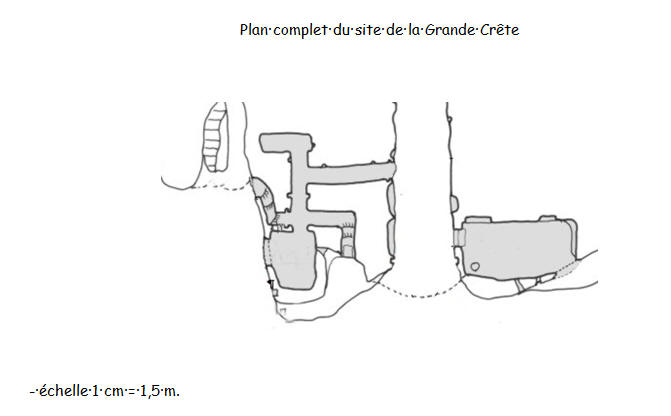
La partie Ouest a été creusée dans une falaise verticale et sous un abri
sous roche. Elle comprend un système de couloirs orthogonaux et une
salle.
La partie Est a été creusée dans la paroi de la grotte. Elle comprend
une salle en hauteur Cette cavité concomitante a fait l’objet d’une
fouille par M. G. Chauvet en 1870, fouille qui avait donné des outils
Solutréen et du Magdalénien.
Ces principales caractéristiques en sont :
--
aménagement des parois dans la grotte,
--
chatière,
--
couloir de 10 m. de longueur,
--
couloirs orthogonaux,
--
dalle de fermeture de couloir,
--
escalier de 5 marches ?
--
feuillures de fermeture et virgules de blocage,
--
passage aérien en corniche et par passerelle ?
--
salle de 2 m. sur 2m,
--
salle de 4 m. sur 2,5 m,
--
trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.
Il est à noter que ce site aurait connu plusieurs périodes d’occupation
: à savoir :
--
occupation haut Moyen Age. (découverte d'un chrisme)
--
période du creusement d’un souterrain refuge.
--
période d’aménagement d’un site troglodytique.
--
destruction du site.
Note : Dans la grotte qui a été réaménagée en habitat troglodytique ont
été repérés plusieurs dessins pariétaux non figuratif (chrisme,
poissons, grille, etc.)
3
-
Site de forêt : Site du
Souterrain de Chément à Garat. (Réf SRA -0016-7838)

Présentation du contexte géomorphologique du site de Chément.
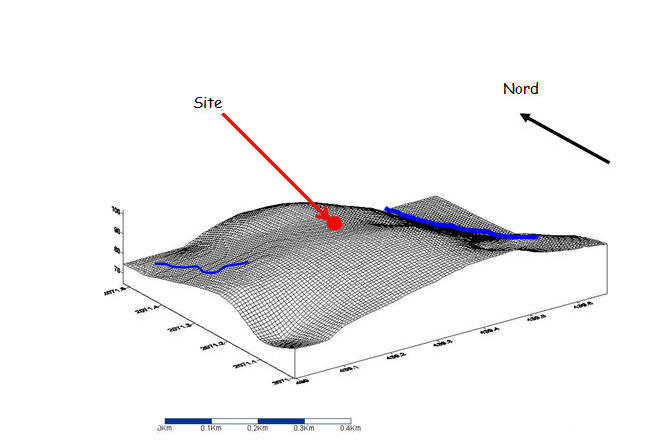
Ce site creusé dans le calcaire Kimméridgien inférieur du
Crétacé se trouve sur le versant Ouest de la vallée de l’Echelle, dont
il est distant de 220 m. Son accès initial se faisait par le haut d’une
légère butte en bordure d’un bois vraisemblablement sous un tertre
artificiel très allongé, le tout recouvert actuellement d’arbres
bicentenaires et d’une végétation calcicole qui cachent pratiquement
l’ensemble.
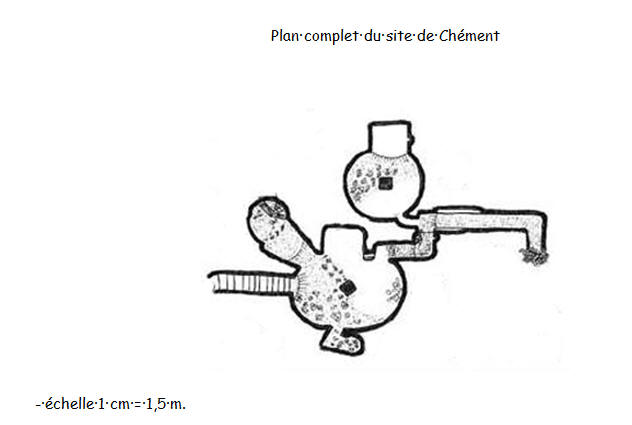
Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Un long
couloir avec des angles orthogonaux, actuellement recouvert d’une butte,
fait communiquer la surface avec deux salles hémisphériques. Ce couloir
a été creusé à ciel ouvert et recouvert sur toute sa longueur par des
dalles plates.
Un escalier de 11 marches, de construction plus récente donne accès à la
plus grande des salles.
Ces principales caractéristiques en sont :
--
chatière,
--
couloirs orthogonaux de 14 m. de longueur,
--
deux puits d’extraction de matériaux,
--
deux salles hémisphériques,
--
feuillures de fermeture et virgules de blocage,
--
piliers centraux dans les deux salles hémisphériques,
--
trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.
Note : un ancien silo à grains a été partiellement détruit pour servir
de puits d’extraction des matériaux d’une des salles.
4 - Site de butte : Site du
Souterrain de Fontignoux à Villebois.
(réf SRA N°005-16259)
.jpg)
Présentation
du contexte géomorphologique du site de Fontignoux

Ce site creusé dans le calcaire Santonien inférieur, se trouve sur une
butte au sud de la butte du château de Villebois-Lavalette.
Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Le couloir
d’accès initial n’est actuellement pas connu. L’accès actuel se fait par
un puits d’extraction de matériaux dont les dalles de couverture se sont
effondrées.

Dans le site, un couloir rectiligne fait communiquer entres elles trois
salles de dimensions variables. Un deuxième puits d’extraction existe à
l’autre extrémité du site.
Ce site est particulièrement intéressant pour son système de défense
passive élaboré dans une salle, avec trous de surveillance, meurtrières
et assommoir.
Ces principales caractéristiques en sont :
--
angle orthogonal du couloir initial d’accès,
--
assommoir,
--
chatière,
--
dalles de couverture d’un des puits d’extraction,
--
deux puits d’extraction de matériaux, dont un est vide,
--
meurtrières,
--
trois salles, dont une de défense,
--
trous de surveillance de l’intérieur vers l’extérieur.
Sa position dominante sur un point haut du canton de Villebois-Lavalette
semble avoir été déterminante pour son creusement. Il offre un panorama
de 360° avec des vues:
--
Sud sur la vallée de la
Lizonne et la Dordogne actuelle,
--
Ouest sur les reliefs de
Juillaguet et Charmant,
--
Nord vers la butte de
Villebois et l’Angoumois,
--
Est sur les reliefs de la
forêt d’ Horte.
Note : Actuellement, cette position haute a été repérée par l’armée de
l’air qui, lors des manœuvres aériennes annuelles, y établit son poste
de commandement, ainsi qu’un radar.
5
- Site de plaine : Site des
Courasses à Dignac.
(Réf SRA -16 119 10 AH)

Présentation
du contexte géomorphologique du site des Courasses
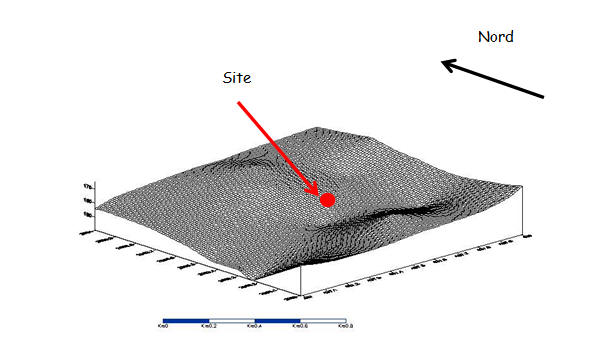
Ce site creusé dans le calcaire Coniacien se trouve dans
une plaine formant dépression. Aucun cours d’eau, peu d'habitations ne
se trouvent dans sa proche périphérie. Seul le hameau du Lac se situe à
environ 500 m. du site.
Il s’étale sur un même niveau et a été creusé dans le géol. Le site est
connu dans son exhaustivité : un sondage de dégagement du couloir a été
effectué en 2000.
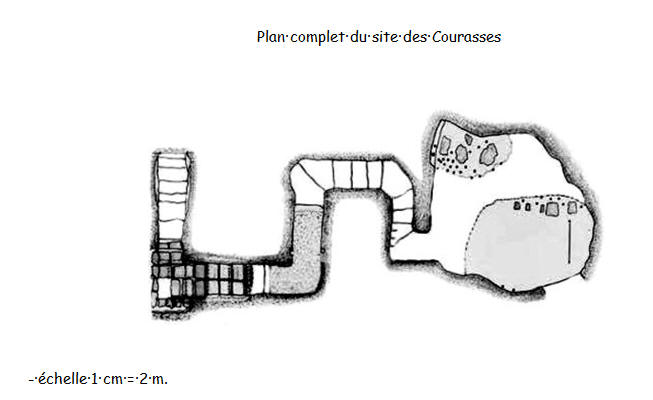
Dans le site, un couloir orthogonal en escalier, fait communiquer la
surface à une salle souterraine de moyennes dimensions (3.25 m. sur 2.80
m.). Cette salle est située à 6 m. sous le T. N.
Ce site est particulièrement intéressant pour deux raisons :
--
les particularités de sa découverte permettent de penser que ce site
était vierge et dans l’état depuis son abandon vers le XIIIe.
--
au cours du sondage ont été découverts des anciens silos à grains
qui pourraient correspondre avec un habitat de surface. Du mobilier
céramique daté du XIe et XIIe a été également
découvert dans ce site.
Ces principales caractéristiques en sont :
--
angle orthogonal du couloir initial d’accès,
--
dalles de couverture du couloir en bâtière,
--
deux silos à grains dont un rempli,
--
escaliers de 22 marches,
--
puits d’extraction de matériaux actuellement rempli.
Note :
Ce site et l'occupation de surface qui en découle a été inscrit dans un
programme de fouille de 2003 à 2008. (responsable scientifique de
l'opération Guy Roger)
Chapitre III
- Le mobilier
Nous dirons
quelques mots sur le mobilier et plus particulièrement sur les
céramiques qui constituent l’essentiel de nos découvertes. En l’absence
d’une véritable fouille archéologique nous n’avons fait que récolter ce
qui pouvait se présenter à la surface des remplissages. Aussi les
renseignements ne peuvent-ils être qu’insuffisants. Toutefois, ces
maigres indices nous donnent des indications non négligeables qui nous
permettent de faire les remarques suivantes :
Le fait le plus remarquable qui
caractérise en premier le mobilier céramique est que la carène des
tessons formant épaisseur et donc résistance n'a pas subi l’écrasement
des passages dans les couloirs ou les salles, contrairement aux parties
plus fines des panses qui ont été dans de nombreux cas pulvérisées ou en
tout cas très fragmentées par les passages successifs dans les étroits
couloirs de circulation. Et cela même pour des sites découverts vierges
de toute pénétration contemporaine. Ce qui permet de penser que les
passages après le creusement et avant le comblement y ont été
importants.
En
grande majorité, la céramique est fine à très fine, la pâte grise à
rose. Il s’agit d’ustensiles domestiques connus, en général de taille
modeste, noircis au feu sans ou avec décors simples, types pots,
cruches, pichets, couvercles, pégaus, etc, souvent brûlés par le feu.
Plus rarement la pâte est recouverte de glaçure ordinairement verte et
exceptionnellement jaune. La plupart de ces céramiques semble pouvoir
être datée entre les Xe et XIIIe siècles.
Les sites qui sont non protégés du public, ne comportent plus de
mobilier visible, ces derniers ayant été pillés. Egalement des
obstructions volontaires ont pu être faites à des époques très diverses,
à l’aide de matériaux hétéroclites.
Remarque : L’élément le
plus recherché étant précisément l’époque du creusement, il est
intéressant de savoir que lors du creusement d’un souterrain comme nous
l’avons vu plus haut, le puits d’extraction des matériaux n'à été creusé
que pour permettre une extraction facile des matériaux du sous-sol.
L’espace temps où cette structure est restée vide serait donc
relativement court (de quelques jours à quelques semaines). Le
creusement terminé, ce ou ces puits devaient donc obligatoirement être
comblés une fois pour toute. Le mobilier inventorié dans ces rebouchages
nous permet d’affiner par déduction la période du creusement du site
lui-même. La même remarque pourrait être applicable aux couloirs qui
auraient été comblés ou détruits volontairement.
Les matériaux découverts dans les dégagements de ces parties de
structure, nous donneraient des datations plus précises qui, par
opposition, nous permettraient d’approcher deux dates importantes :
datation du creusement & datation du comblement.
En dehors des charbons et des tessons de poterie qui constituent la plus
grande masse du mobilier archéologique de ces creusements, nous avons
découvert ; quelques silex retouchés, de la tuile type "tégulae", des
fragments de meules, des fragments d’objets en fer, des pièces de
monnaie (XIVe, XVe et XVIIe), des
scories, des ossements d’animaux.
Exemple de céramique découverte
(site des Courasses à Dignac)

Chapitre
IV - Problématiques
Souterrains
Les creusements anthropiques sont
des édifices particuliers, chaque occupant successif le réaménage selon
ses besoins et efface souvent les traces de ses prédécesseurs. L’analyse
de la répartition des sites et l’examen des aménagements internes,
laissent penser à une utilisation de défense. Mais si l’aspect défensif
semble en être la tendance générale, il ne faut pas confondre le
"comment" du "pourquoi".
Dans le cas des souterrains, la cause du creusement initial semble bien
en être la défense, mais le but en est l’habitat, ou plus exactement la
sécurité et l’on peut même, en fonction des conditions de vie à
l’intérieur d’un tel site, le déterminer comme un "habitat sécuritaire
temporaire"
Cette dualité est importante car si l’habitat est temporaire, la défense
domine ; s’il est permanent le creusement devient un habitat
troglodytique. D’où la nécessité, pour saisir le rôle de ces creusements
d’étudier à partir de quels besoins impérieux leur création a été faite.
Par le fait que ces structures sont en place, plus ou moins relativement
protégées par des effondrements ou des comblements, le "comment" semble
relativement aisé à déterminer. A l’intérieur de ces sites des fouilles
stratigraphiques devraient nous permettre d’avoir une approche précise
des différents niveaux d’élaboration, d’occupation et d’abandon de ces
sites.
Quant au "pourquoi" les sources écrites sont très peu nombreuses
et ce n’est seulement qu’à partir de fouilles programmées et par leurs
synthèses que les archéo-subterranologues pourront dégager des
hypothèses de travail.
Silos à Grains
Ces creusements étant facilement identifiables et afin de ne pas faire
d’amalgame entre fosses et silos, nous avons fait le choix délibéré
d’attribuer la terminologie de "silos à grains" à toute structure dès
qu'elle présente les caractéristiques suivantes :
--
Situations géologique et
géomorphologique.
--
Morphologie de la structure :
forme ovoïde avec un col d’ouverture.
--
Dimensions "standard" (accès
0,40 m à 0,60 m, profondeur 1,50 m à 2,20 et largeur intérieure de
l’ordre de 1,00 m à 1,60 m.).
--
Aspect lisse des parois ainsi
qu'identification de traces d’usure et d’usage.
Si pour les silos, les contraintes géologiques conditionnent dans une
large mesure leur réalisation et leur fonctionnement, leur utilisation
est étroitement liée aux traits sociaux du groupe qui les utilise. Bien
que certains chercheurs
y voient un usage cultuel, nous n’abonderons pas dans ce sens. En
effet : l’architecture de ces structures, leur implantation
géomorphologique, les descriptions faites par le passé; antiquité, moyen
age, période plus récente,
ne peuvent que nous encourager à déterminer comme fonction initiale à
ces creusements une utilisation aratoire. Dans cette hypothèse, l’on ne
peut soustraire l’économie vivrière qui s’y attache et envisager la
présence de communautés villageoises dans leurs environs immédiats.
Dans la réflexion qui va suivre, nous avons pris exemple de la
découverte d’un silo isolé dans un espace isolé (champ)
et dont la contenance serait estimée à environ 1 100 litres.
— Au Moyen Age une ration par personne est d’environ 730 g de grains
par jour
soit 266 kg/an, représentant un volume de 3,50 hectolitres. La cellule
sociale minimale de base théorique est d’au moins quatre personnes (deux
parents et deux enfants), ce qui représente une consommation annuelle de
14 hectolitres.
Si l’on considère que les silos, comme il a été dit précédemment,
fonctionnent en atmosphère anoxique et qu’une fois ouverts, leur contenu
doit être consommé rapidement, trois hypothèses sont envisageables :
Soit ce silo dépendait d’unités domestiques et représentait un lieu
de stockage destiné à l’alimentation des cellules familiales. Dans cette
hypothèse un seul silo connu ne représente pas une réserve suffisante
pour stocker une économie vivrière annuelle pour un groupe. Dans le cas
où un groupe vivait dans les environs immédiats, on peut envisager que,
dans la proche périphérie, d’autres silos sont à rechercher.
Soit le silo permettait un stockage spéculatif, représentant des
réserves à plus long terme pour pallier une mauvaise récolte. On peut,
dans ce cas, envisager qu’un petit groupe pouvait vivre à proximité
Soit le silo était un lieu de stockage de semences pour l’année
suivante. Dans cette hypothèse, avec un rendement de un pour cinq qui
est un rendement maximum attesté
pour cette époque, il représente à lui seul des réserves de semence pour
une population d’environ 15 à 17 personnes. Cette population aurait pu
être fixée dans les environs immédiats de ce site —
Nouvelles perspectives de recherches
Comme dans la fouille de cavité naturelle de période préhistorique, il
existe dans les silos/souterrains ainsi que dans les abris
troglodytiques l'effet de paroi négatif. Cette particularité présente
l'avantage d'offrir au fouilleur une couche archéologique de
conservation privilégiée par rapport à l'ensemble du site qui, a cause
de l'étroitesse des couloirs, a souvent connu de nombreux passages
destructeurs. Cette couche pourrait nous apporter en plus d'une
chronologie de creusement, une chronologie d'occupation.
Au chapitre "habitabilité d'une structure souterraine", nous avons fait
remarquer "qu'une fois repéré dans le site par un agresseur, aucune
fuite n'était possible. Cela peut ne pas être tout à fait exact car,
si au moment de l'élaboration du contexte souterrain, un aménagement
particulier a été prévu, le puits d'extraction qui a servi à la
conception du site peut être conçu de telle façon que son vidage par
l'intérieur donne accès à la surface et devient donc une issue de
secours. Nous avons souvent remarqué que les dalles basses en position
de bâtière maintiennent le contenant du puits. Par prudence nous n'avons
jamais essayé d'expérimenter cette théorie car le volume de matériaux en
suspend derrière ces dalles peut représenter plusieurs tonnes. Les
croquis ci-après expliquent ce concept qu'il serait intéressant de
vérifier.

Pour l'année 2003, ont été demandées 5 autorisations de sondage sur les
sites suivantes avec les problématiques et objectifs suivants :
--
Dignac (Les Courasses) - géomorphologie — plaine,
silos, habitat ?
sondage autour du silo découvert pourrait nous confirmer si
cette zone a connu une occupation agricole.
sondage dans le puits d'extraction, pourrait nous donner des
éléments de datation quant à la période du creusement de ce puits (ce
dernier ayant été obligatoirement comblé immédiatement après son
creusement).
--
Dirac (Baloge) - géomorphologie — bas de falaise,
silos, abri troglo, carrière.
sondage sur la liaison de la partie haute vers la partie
basse, pourrait nous expliquer comment ont fonctionné les creusements
suivants : silos, souterrains, abri troglo, carrières.
--
Edon (Crête)
- géomorphologie — haut de falaise, occupation chronologique :
solutréen, moustérien, azilien, occupation religieuse (IVe),
souterrain-refuge, habitat troglo.
sondage sur l'entrée initiale du souterrain pourrait nous
donner la chronologie du comblement de ce site qui, de toute évidence,
est passé d'un souterrain aménagé à un abri troglodytique (fort troglo ?).
--
Garat (Chément) - géomorphologie — colline, bois,
silo, source.
sondage sur le couloir d'accès où il semble qu'il y ait eu
action volontaire pour détruire les dalles de couverture dudit couloir,
pourrait nous confirmer ou infirmer dans cette hypothèse.
--
Villebois-Lavalette (Fontignoux) géomorphologie —
butte, fonction défensive ?
sondage autour des dalles de couverture d'un des puits
d'extraction, qui pourrait nous permettre d'établir une datation quant
au creusement de ce puits et de sa fermeture (il est à noter que le
creusement du puits et sa fermeture sont obligatoirement de la même
période).
En plus la consolidation de la couverture, permettrait de protéger
efficacement ce monument.
Chapitre
IV - Conclusion
Pour situer l'environnement humain des différents creusements que nous
venons de voir il a semblé nécessaire de fixer quelques repères
d'occupation dans ce secteur.
Les premières manifestations humaines attestées remontent au
Paléolithique ancien avec les découvertes de nombreux gisements sur les
hautes et moyennes terrasses qui bordent les cours d'eau du Bandiat, de
la Lizonne, de la Manore, du Voultron, de l'Echelle, de l'Anguienne, des
Eaux Claires, du Charreau, de la Boëme…
Au Mésolithique ancien les nombreuses buttes alluvionnaires, surtout
dans l'Est du secteur, ont fixé quelques populations de
chasseurs-cueilleurs, sur les horizons sableux-argileux… (Buttes de
Nebout et Chalard à Combiers, de la Martinie à Rougnac, de Raffinie à
Villebois-Lavalette).
Les périodes plus récentes (Néolithique, Protohistorique) sont
logiquement dans la ligne des occupations humaines antérieures mais, ou
fragilité des sites ou négligence de la recherche ou tout simplement
inoccupation humaine, les indices y sont moins représentatifs. Néanmoins
bien que parcellaire, on trouve traces de ces périodes d'occupations sur
pratiquement toutes les communes de notre secteur.
Ce n'est que pendant la période romaine que le maillage d'occupation au
sol va prendre son importance pour donner à ce secteur une physionomie
qui va exister un millénaire plus tard. Mais dans l'état actuel de nos
recherches, il n'est pas possible de pouvoir démontrer l'imbrication du
maillage d'occupation romaine, de loin la plus importante, avec le
maillage des occupations liées aux silos et aux souterrains. En effet
aucun élément ne permet dans ce secteur d'établir de connexions
topographiques entre les périodes Gallo-romaines et les périodes
Médiévales.
Quelques siècles plus tard après le "brouillard" qui succéda à la chute
de l'empire Romain, à la charnière du premier/deuxième millénaire, avec
les nouvelles organisations agricoles en zone rurale va apparaître une
nouvelle avancée économique et sociale.
Et c'est en toute logique durant cette période, que les premiers
creusements de silos à grains et de souterrains feront leur apparition
prés des habitations rurales. De façon évidente, leurs fonctions
utilitaires seront en rapport direct avec des fonctions aratoires de
surface. Ainsi les liens pragmatiques entre habitat et creusement sont
faciles à déterminer :
1.
La géologie du sous-sol se prête à ces types de creusements et
d'aménagements.
2. Une
production agricole fluctuante crée un besoin de stockage sécuritaire à
moyen et long terme.
3. En périodes troubles dans des secteurs très peu sécurisés, les
autochtones en zone rurale et isolés, ressentent le besoin de se créer
un système de structures de défense passive face à l'impossibilité de
s'intégrer dans un système de défense collective.
4. En
dehors de la pénibilité du travail, l'élaboration de telles structures
ne demande que très peu de moyens financiers.
Le canton de Soyaux, comme celui de Villebois Lavalette, présente
approximativement le même pourcentage de sites. Comme il a déjà été
précisé, le contexte hydrographique en sera le principal vecteur, mais
pas plus dans un canton que dans l'autre il n'a été remarqué une
concentration de sites autour des agglomérations actuelles.
Une dernière remarque s'appliquera à l'état de conservation de ces
sites. L'état des lieux est très dégradé. La vulnérabilité des sites et
l'irréversibilité de leur destruction rendent ce patrimoine très
fragile. Heureusement actuellement la couverture forestière relativement
importante sur ce secteur contribue à mettre à l'abri une grande
majorité de sites des méthodes dévastatrices de l'agriculture moderne.
Mais l'intensification d'ouvertures de carrières d'extraction de grés
silico-ferrugineux, met en péril la sauvegarde de ces monuments par la
destruction de nombreux marqueurs archéologiques. D'autant plus que les
gisements de ces minéraux se trouvent très souvent dans les fonds et
bordures d'anciennes vallées sèches ou encore humides où l'activité
humaine y a été importante.
Même si notre travail sera inévitablement entaché de quelques lacunes et
erreurs, il pourrait néanmoins servir de base à de possibles travaux
futurs et il serait souhaitable que les services archéologiques ne
considèrent plus ces lieux comme des pièces annexes à des généralités,
car grâce à leur conservation privilégiée, ces sites souterrains se
révèlent être de précieux réservoirs archéologiques et ethnographiques
et à ce titre ils devraient être conservés, étudiés et protégés.
Chapitre V
-
Synthèse
Bien qu’un choix ait été fait pour déterminer une zone de prospection,
la découverte et l’étude de ces 135 sites, ne résultent que de
circonstances telles que : documentations disponibles, découvertes
fortuites, proximité associative. L’hypothétique de ces découvertes
permet de constater le maillage relativement important de ces sites sur
les deux cantons puisqu'on retrouve en moyenne un site tous les 300
hectares, soit un maillage kilométrique d’un site tous les 5,4
kilomètres.
Les 135 sites offrent un large éventail environnemental et
morphologique, ce qui rend leur comparaison aléatoire. Néanmoins deux
points communs s’en détachent ; la géologie et l’anthropologie. Si la
géologie a joué un rôle déterminant dans l’implantation des sites
souterrains, l’occupation humaine en a été le facteur prédominant.
Trois grands groupes se distinguent ; les silos, les souterrains et les
aménagements troglodytiques, bien que d’architecture et de
fonctionnalité différentes, ces trois types de creusements souvent
limitrophes, parfois proches, quelquefois imbriqués, semblent avoir fait
partie de choix, de conséquences et de similitudes les uns par apport
aux autres.
Silos :
l’organisation spatiale des silos ne semble correspondre à aucun ordre
établi. Bien que la fonction aratoire de ces creusements semble ne faire
aucun doute, certains silos se chevauchent, se détruisent même. Il
semble qu’un besoin immédiat ait été le principal facteur d’implantation
des creusements. L’étude des secteurs d’ensilage donne une impression de
dispersion anarchique, dans la limite d’une zone de travail, elle-même
délimitée par un sous sol géologiquement favorable. Nous pourrions y
voir là une nécessité créée par des besoins saisonniers ou/et même des
quantités des récoltes aléatoires.
S’il est difficile d’établir une chronologie d’occupation de ces aires
"agro-artisanales" certaines connexions topographiques permettent de
penser que l’antériorité du creusement des silos ne fait aucun doute par
rapport aux souterrains.
En général on peut situer l’élaboration de ces silos plutôt dans des
périodes de prospérité que dans des périodes de récession.
Souterrains :
a l’intérieur de ces structures, malgré les aménagements différents, on
retrouve approximativement les mêmes équipements. Les plus répandus
sont :
--
entrées camouflées,
--
couloirs souvent de conception orthogonale,
--
systèmes de chicanes,
--
des feuillures de fermeture,
--
des trous de surveillance,
--
des salles.
A noter également une certaine stéréotomie dimensionnelle; hauteur de
1,50 à 1,65 m., largeur des couloirs de 0,60 à 0,80 m., dimensions
totale du site dans son entité de 14 à 20 m.
Nous avons souvent été décriés pour avoir une vision guerrière quant à
la destination de ces ouvrages. Mais nous ne pouvons envisager une
fonction utilitaire et pacifique, lorsque 100 % de ces sites comportent
des feuillures de fermeture destinées à recevoir une fermeture menuisée.
Ces feuillures ont été creusées de manière à pouvoir barricader le
souterrain de l’intérieur. Elles renforcent la notion de refuge car de
surcroît elles sont souvent associées à des trous de surveillance
coniques qui mettent en communication visuelle et phonique la ou les
salles intérieures avec les couloirs d’entrée. L’importance de ces
détails est capitale dans la destination du site en évoquant un souci
indéniable de défense passive.
En règle générale les périodes troubles contribuent à créer un climat
insécuritaire et l’on peut envisager que, contrairement aux populations
des villes qui elles pouvaient faire preuve d’une grande solidarité
défensive, les communautés rurales, où se situent la majorité de ces
sites, furent amenées à élaborer avec une pauvreté des moyens ces
structures de protections familiales.
Abris troglodytiques
: ce type
d’aménagement de cavité ou de modification d’abri sous roche est
particulier par le fait qu’il ne peut s’implanter que dans des falaises
où la roche affleure. Pour cette raison on ne le trouve que sur les
rives des vallées sèches ou humides. Certains sites développent une
chronologie de creusement qui passe successivement par :
--
silo,
--
souterrain,
--
l’habitat de falaise.
le tout ayant été quelquefois précédé par une occupation préhistorique
de la cavité ou de la grotte.L’histoire
de ces creusements semble donc liée étroitement avec les origines du
village, le creusement soit des silos soit des souterrains est avant
tout le fait d’une population fixée dans sa proche périphérie.
Le mobilier trouvé sur place ainsi que les quelques documents semblent
nous fixer sur des habitats médiévaux aux limites incertaines mais qui
laissent entrevoir comme limite haute le Xe et comme limite basse le
XIIIe.
Chapitre
VI - Sources
-
Aeberhardt André -
L’angoumois Gallo-Romain, Université de Tours, Centre de
recherche A. Piganiol, Tours, 1983.
-
Avrilleau Serge -
Cluzeaux et Souterrains du Périgord, Editions Libro-Liber,
Saint Astier, 1993, 1994, 1996.
-
Blanchet Adrien - Les
Souterrains-refuges de la France, Auguste Picard, Paris,
1923.
-
Bosson A. Études
Agronomiques d’après des géorgiques de Virgile, livre
premier, Pigoreau, Paris, 1942.
-
Bourin Monique & Durand
Robert – Vivre au Moyen Age, Les solidarités paysannes du 11e
et 13e siècles, Messidor/Temps Actuels, 1984.
-
Broens Maurice - Le
France souterraine, PUF, 1955.
-
Broens Maurice – Le
paganisme médiéval en Germanie danubienne, Chthonia, Centre
International de recherches anhistoriques, N° 5 – 6, Herder,
Barcelona. 1961.
-
Chapelot Jean & Fossier
Robert – Le village et la maison au Moyen Age, Hachette,
Paris, 1980.
-
Chauvet Gustave –
Bulletins et Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 5éme série, t.
IV, 1881.
-
Daniou P. Les dépôts
détritiques des confins de la Charente et du Périgord, Thèse
de doctorat de 3éme cycle, Université de Bordeaux III, 1981.
-
Daniou P. L'homme et
les grés au sud de la Charente, Bulletins et Mémoires de la
S.A.H.C, Angoulême, 1er trimestre, 1984.
-
Debord André – La
Société Laïque dans les pays de la Charente au Xe et XIIe
siècles, Picard, 1984.
-
Dedet B. & Pène J. M. -
Étude des silos de l’Ariasse à Vic-le-Fesq (30), Doc. d'Archéo.
Méridionales, N° 18, 1995,
-
Dedet B. & Pène J. M. -
Étude d’un habitat non perché de faciès Suspendien dans les
garrigues, Doc. d'Archéo. Méridionales, N° 18, CNRS, UMR
154, Nîmes, 1995.
-
Duguet J. – Noms de
lieux des Charentes, Editions Bonneton, 1995.
-
Duvernois J. – Dissidents
du Pays d’Oc, Privat 1994.
-
Favraud A.- Bulletins et
Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 1916.
-
Gady Serge – Les
souterrains médiévaux du Limousin, Documents archéologie
Française. N° 19, Editions de la Maison des sciences de l’Homme,
Paris, 1989.
-
Gast M. & Sigaut F. -
Les techniques de conservation des grains à long terme,
Paris, CNRS, 1981.
-
Gauguié Alcide – La
Charente communale illustrée, Angoulême, 1868.
-
Giot P. R. – Les
souterrains armoricains de l’âge du Fer, Annales de
Bretagne, 1960.
-
Guérin A. & Boutaud –
Bulletins et Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 1901, 1902.
-
Higounet Charles –
Histoire de l’Aquitaine – Univers de la France, Privat,
1971.
-
Joanne A. - Descriptif
de la Charente, 1868.
-
Laffite H. – Bulletins et
Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 7° série, t. VIII, 1907-1908
-
Lièvre A. F. – Les chemins Boinés, Melle, 1887.
-
Lièvre A. F. – Les chemins Gaulois et Romains entre Loire et
Gironde, Niort, 1893.
-
Longuemar T. de - Mem. Soc.
des antiquaires de l’Ouest. - Les souterrains-refuges découverts
dans l’ancien Poitou, Recherches archéologiques sur une partie
de l’ancien pays des Pictons, ib, 1855.
-
Lorenz Claude –
Etudes
récentes et essai de classification, Archéologia, Document N°2,
1973.
-
Marinval P. -
Étude des
paléo-semences des silos de Vic le Fesq (Gard), Doc. d'Archéo.
Méridionales., N° 8, 1985.
-
Martin Henri - Bulletins et
Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 1911.
-
Martin-Buchey -
La
géographie historique et communale de la Charente, 1914.
-
Masfrand A. – Bull. Soc. Amis
des Sciences et Arts de Rochechouart, t. IX, 1899.
-
Mauny R. –
Les sculptures
érotiques et hérétiques de la cave des Mousseaux à Dénezé, Bull.
de la Section Française du C.I.R.A.C. Actes de Cordes de 1967, 1969.
-
Mercier – Bulletins et
Mémoires de la S.A.H.C, Angoulême, 1875.
-
Michon J. H. –
Statistique
monumentale de la Charente, Derache, Paris, 1844.
-
Moreau Hugues –
L’angoumois
pendant la guerre de Cent Ans – Dossier DEA 1992, Poitiers,
1993.
-
Mortillet. -
Souterrains de
grottes artificielles de France, Revue de l’école
d’Anthropologie, sept. 1908.
-
Nollent P. -
Fosses à
offrandes découvertes près d’Artenay, Bulletin trimestriel de la
Société Archéologique de l’Orléanais, Nouv. Série, T. V, 1er
trimestre, 1969.
-
Peyraud Fabrice –
Le
complexe hydro géographique des rivières Sud de l’Angoumois,
Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de la
Boëme, 1991.
-
Piboule P. & Gady S. -
Fouilles et découvertes de souterrains aménagés, Revue
Archéologia, N° 2, 1973.
-
Piboule Patrick –
Les
souterrains aménagés du Châtelleraudais, extrait d’Archéologie
Médiévale, I, 1971.
-
Pline - H. N., V 8,
Troglodytae specus excavant.
-
Py – Chausserie, 318, 1978.
-
Raynaud Claude –
Le village
Gallo-romain et médiéval de Lunel Viel (Hérault), La fouille du
quartier Ouest, Document Archéologie Méridionale, 1981-1983.
-
Rewerski J., Gilbert C. -
Le monde souterrain de l’Anjou, La Nouvelle République, Tours,
1986.
-
Reynols P. J. -
A général
report of underground, storage experiments at the Busther ancient
farm research projet, traduit Gast M. & Sigaut F., Le rôle de
la conservation des grains dans la dynamique des systèmes de
cultures et des sociétés, (T. I et T. II), Paris, CNRS, 1979.
-
Rochebrune T. de - Mem. Soc.
des Antiquaires de l’Ouest, Matériaux hist. de l’homme, 1865.
-
S.F.E.S. – Société française
d’Etudes des Souterrains, Siége Social Mairie d’Artenay, 45410.
-
Sigaut F. -
Les réserves de
grains à long terme, Ed. de la Maison des Sciences de l’homme,
Publications de l’Université de Lille III, 1978.
-
Tacite - t.
1er, an IX.
-
Vaquer J. -
Étude des Silos
de Carsac à Carcassonne, Guilaine et Al, 1986.
-
Textes du XIIe – XVe
s. concernant l’Age du Fer en Sicile - Bresc 1979.
Bibliographie
– Références Régionales.
-
Aeberhardt 1987
: Aeberhardt (André) — souterrain, commune de Saint Cybardeaux,
lieu dit Logis des Bouchauds, BSAHC, pp. 39-41, 1987.
-
Arnoult 1949 : Arnoult (Bernard) — souterrain, commune de
Barbezières, lieu dit Bourg, BSAHC, p. 51, 1949/1950.
-
Barth 1965 : Barth — souterrain, commune de Saint Hilaire
de Barbezieux, lieu dit Bourg, BSAHC, 1965, séance du 10 juin
1965.
-
Brignon 1926 : Brignon — souterrain-refuge, commune de
Monboyer, lieu dit Baillou, BSAHC, 1926/1927, séance du
10/11/1926.
-
Brignon 1927 : Brignon — souterrain-refuge, commune de
Brossac, lieu dit Mesnier, BSAHC, 1927, séance du 13/04/1927.
-
Brignon 1927 : Brignon — silo, commune de Chalais, lieu
dit Counilière, BSAHC, 1927, séance du 13/04/1927.
-
Brignon 1930 : Brignon — souterrain, commune de Saint
Quentin de Chalais, lieu dit Brugier, BSAHC, 1930, séance du
12/02/1930.
-
Brignon 1932 : Brignon — souterrain-refuge, commune de
Sainte Marie, lieu dit Fouquet, BSAHC, 1932, séance du 10
février 1932.
-
Bruneteau 1870 : Bruneteau — souterrain, commune de
Chateauneuf, lieu dit Grand Montet, BSAHC, 1870.
-
Buisson 1984 : Buisson (Jean François) — silos, commune
d’Angoulême, lieu dit bd A. Briand, BSAHC, fasc. N° 3, 1984,
séance du 14/11/1984.
-
Castest 1928 : Castest (abbé) — souterrain-refuge, commune
de Essards, lieu dit Puycheny, BSAHC, 1928, séance du
11/07/1928.
-
Chauvet 1895 : Chauvet (Gustave) — souterrain-refuge,
commune de Balzac, lieu dit Moulin-Massé, BSAHC, 1895, séance du
11/12/1895.
-
Chauvet 1895 : Chauvet (Gustave) — souterrain, commune de
Poursac, lieu dit Signac, BSAHC, 1895, séance du 20/11/1895.
-
Chauvet 1905 : Chauvet (Gustave) — souterrain, commune de
Agris, lieu dit Camus, BSAHC, 1905, séance du 14/06/1905.
-
Chauvin-Souchard 1946 : Chauvin-Souchard — souterrain,
commune de Mareuil, lieu dit Plessis, BSAHC, 1946.
-
Chauvin-Souchard 1950 : Chauvin-Souchard —
souterrain-refuge, commune de Aubeville, lieu dit Dourville,
BSAHC, 1950, séance du 17/04/1950.
-
Chauvin-Souchard & Bananger 1949 : Chauvin–Souchard &
Bananger — souterrain, commune de Barret, lieu dit Peye -
BSAHC, 1949.
-
Chauvin-Souchard & Bananger 1963 : Chauvin-Souchard &
Bananger — souterrain, commune de Barret, lieu dit Eglise,
BSAHC, 1963, séance du 14/11/1963.
-
Cointat & Mouton & Duvernet 1925 : Cointat & Mouton &
Duvernet — souterrain-refuge, commune de Pillac, lieu dit Bourg,
BSAHC, 1925, séance du 11/03/1925.
-
Corbin 1983 : Corbin (J.) — souterrain-refuge, commune de
Aubeterre sur Dronne, lieu dit Bourg, Histoire d'Aubeterre sur
Dronne, 1983.
-
de la Bastide 1920 : de la Bastide — souterrain-refuge,
commune de Exideuil, lieu dit Bastide, BSAHC, 1920, séance du
12/05/1920.
-
de la Bastide 1931 : de la Bastide — souterrain, commune
de La Péruse, lieu dit Eglise, BSAHC, 1931.
-
de Rochebrune 1870 : de Rochebrune — souterrain, commune
de Jurignac, lieu dit Bourg, BSAHC, 1870, séance du 13/07/1870.
-
Deschamps 1987 : Deschamps (André) — souterrain, commune
de Saint Laurent de Belzacot, lieu dit Pissaudiére, BSAHC, N° 1,
1987, séance du 14/07/1987.
-
Dubourg-Noves 1979 : Dubourg-Noves — souterrain, commune
de Champniers, lieu dit Puy de Nelle, BSAHC, 1979-1980, séance
du 14/11/1979.
-
Dubourg-Noves 1981 : Dubourg-Noves — souterrain, commune
d'Angoulême, lieu dit hospice de Beaulieu, BSAHC, 1981-1982,
séance du 11/02/1981.
-
Dubourg-Noves 1981 : Dubourg-Noves — souterrain-refuge,
commune de Segonzac, lieu dit Collet, BSAHC, 1981/1982, séance
du 14/01/1981.
-
Duport 1979 : Duport (Louis) — souterrain, commune de
Aussac, lieu dit Vadalle, BSAHC, 1979-1980, séance du
13/06/1979.
-
Favraud 1916 : Favraud (A.) — souterrain + silos, commune
de Mouthiers sur Boëme, lieu dit Bournet, BSAHC, 1916, séance du
12/04/1916.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Aunac,
lieu dit Château, Notes historiques sur les communes de l'ancien
arrondissement de Ruffec, p. 134.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Brettes,
lieu dit Logis, Notes historiques sur les communes de l'ancien
arrondissement de Ruffec, p. 100.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Courcome,
lieu dit Magné, Notes historiques sur les communes de l'ancien
arrondissement de Ruffec, p. 13.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Ligné,
lieu dit Bourg, Notes historiques sur les communes de l'ancien
arrondissement de Ruffec, p. 123.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Mouton,
lieu dit Rivières, Notes historiques sur les communes de
l'ancien arrondissement de Ruffec, p. 100.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Paizay-Naudouin,
lieu dit Tourton, Notes historiques sur les communes de l'ancien
arrondissement de Ruffec, p.58.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Saint
Front, lieu dit Chapelle, Notes historiques sur les communes de
l'ancien arrondissement de Ruffec, p.105.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Verdille,
lieu dit Breuil au Loups, Notes historiques sur les communes de
l'ancien arrondissement de Ruffec, p.111.
-
Favraud : Favraud (A.) — souterrain, commune de Villognon,
lieu dit Creux des Fades, Notes historiques sur les communes de
l'ancien arrondissement de Ruffec. , p.95.
-
Flaud 1969 : Flaud — souterrain, commune de Merpins, lieu
dit Motte, BSAHC, 1969, séance du 12/12/1968.
-
Forgerit de la Talonniére 1925 : Forgerit de la Talonniére
(E.) — souterrain, commune de Ambérac, lieu dit Bourg, BSAHC,
1925, séance du 11/03/1925.
-
Gaborit 1957 : Gaborit (G.) — souterrain, commune de
Aussac, lieu dit Eglise, BSAHC, Les églises oubliées du
département de la Charente, 1957.
-
Gaborit 1959 : Gaborit (G.) — souterrain, commune de
Montignac, lieu dit Château, BSAHC, Article sur l'Histoire de la
paroisse de Montignac, p. 63, 1959, séance du 12/03/1959.
-
Gaborit 1959 : Gaborit (G.) — souterrain, commune de
Ruelle, lieu dit Bourg, BSAHC, p. 40, 1959, séance du
12/11/1959.
-
Gaborit 1961 : Gaborit (G.) — souterrain, commune de Auge,
lieu dit Petit Beauvais, BSAHC, p. 31, 1961, séance du
08/06/1961.
-
Gagnére 1984 : Gagnére — souterrain, commune de Foret de
Tesse, lieu dit Bourg, BSAHC, N° 2, 1984.
-
Gauguié 1868 : Gauguié (Alcide) — souterrain, commune de
Marthon, lieu dit Château, Charente Communale Illustré, p. 318,
1868
-
Gauguié 1868 : Gauguié (Alcide) — souterrain, commune de
Mareuil, lieu dit Bourg, Charente Communale Illustré, p. 345,
1868.
-
Gauguié 1868 : Gauguié (Alcide) — souterrain, commune de
Marcillac-Lanville, lieu dit Motte, Charente Communale Illustré,
p. 353, 1868.
-
Gauguié 1868 : Gauguié (Alcide) — souterrain+silos,
commune de Champagne de Blanzac, lieu dit Maison d'Ecole,
Charente Communale Illustré, p. 216, 1868.
-
George 1971 : George (J.) — souterrain, commune de Saint
Front, lieu dit Eglise, BSAHC, Les cryptes de Charente, 1971.
-
Guerin-Boutaud 1901 : Guerin-Boutaud (A.) — souterrain,
commune de Saint Saturnin, lieu dit Tarsac, BSAHC, 1901, séance
du 12/06/1901.
-
Huraux 1980 : Huraux (Patrick) — souterrain, commune de
Saint Brice, lieu dit Eglise, SBAL, Cognac sous Terre, Janvier,
1980.
-
Huraux & Jouannet 1984 : Huraux & Jouannet —
souterrain-refuge, commune de Salle d'Angles, lieu dit Peu de sang,
GREH, N° 6, 1984.
-
Huraux & Jouannet 1984 : Huraux & Jouannet —
souterrain-refuge, commune de Segonzac, lieu dit Voix, GREH, N°
6, 1984.
-
Huraux & Jouannet 1988 : Huraux & Jouannet — souterrain,
commune de Juillac le Coq, lieu dit Bois Berger, GREH, N° 9.
mai, 1988.
-
Huraux & Jouannet 1988 : Huraux & Jouannet — silo, commune
de Juillac le Coq, lieu dit Bois Berger GREH, N° 9. mai, 1988.
-
Lafitte 1907 : Lafitte (Hilaire) — souterrain-refuge,
commune de Yviers, lieu dit Rassac, BSAHC, Note sur le
souterrain-refuge de chez Rassac, 1907/1908, séance du 08/01/1908.
-
Lafitte 1912 : Lafitte (Hilaire) — souterrain, commune de
Monboyer, lieu dit Châtelard, BSAHC, 1912, séance du 11/12/1912.
-
Lafitte 1913 : Lafitte (Hilaire) — souterrain, commune de
Saint Laurent des Combes, lieu dit Gauthon, BSAHC, 1913, séance
du 09/071913.
-
Lafitte 1921 : Lafitte (Hilaire) — souterrain-refuge,
commune de Saint Quentin de Chalais, lieu dit Dougnes, BSAHC,
1921.
-
Lafitte 1923 : Lafitte (Hilaire) — souterrain, commune de
Chalais, lieu dit Puygoyon - BSAHC, 1923, séance du 13 juin 1923.
-
Lafond 1962 : Lafond (Jean Claude) — souterrain+silos,
commune de Sers, lieu dit Lac, BSAHC, 1962-1963, séance du
13/12/1962.
-
Lotte 1967 : Lotte — souterrain-refuge, commune de Brossac,
lieu dit Louainet, BSAHC, 1967, séance du 14/12/1967.
-
Marchadier 1909 : Marchadier — souterrain, commune de
Chateauneuf, lieu dit Lasdoux, BSAHC, 1909, séance du
07/07/1909.
-
Martin 1911 : Martin (Henri) — souterrain, commune de
Gardes le Pontaroux, lieu dit Ligerie, BSAHC, Découverte d'un
souterrain-refuge, 1911.
-
Martin-Civat 1924 : Martin-Civat (Pierre) — souterrain,
commune de Bouteville, lieu dit Brousses, BSAHC, 1924, séance du
12/11/1924.
-
Martin-Civat 1924 : Martin-Civat (Pierre) — souterrain,
commune de Mainxe, lieu dit Eglise, BSAHC, 1924, séance du
12/11/1924.
-
Martin-Civat 1939 : Martin-Civat (Pierre) — souterrain,
commune de Cognac, lieu dit Bourg, Manuscrit de 12 p., Biblio
Municipale de Cognac, Mémoire sur les souterrains pouvant être
utilisés en temps de guerre, MM66, 1939,
-
Maurin 1985 : Maurin (Laurent) — souterrain, commune de
Moulidars, lieu dit Logis de la Cour, Moulidars. Mille ans
d'histoire, 1985.
-
Mazières 1914 : Mazières (abbé) — silo, commune de
Charmant, lieu dit Bourg, BSAHC, 1914, séance du 10/06/1914.
-
Mercier 1875 : Mercier (M.) — souterrain + silos, commune
de Saint André, lieu dit Richemont - BSAHC, 1875,
-
Michon 1844 : Michon (abbé) (J. H) — souterrain, commune
de Montenbœuf, lieu dit Bourg, Statistique monumentale de la
Charente, p. 200, 1844.
-
Michon 1844 : Michon (abbé) (J. H) — souterrain, commune
de Puymoyen, lieu dit Petit Rochefort, Statistique monumentale
de la Charente, p. 239, 1844.
-
Michon 1844 : Michon (abbé) (J. H) — souterrain, commune
de Rancogne, lieu dit Cressiec, Statistique monumentale de la
Charente, p. 652, 1844.
-
Michon 1844 : Michon (abbé) (J. H) — souterrain, commune
de Rougnac, lieu dit Eglise, Statistique monumentale de la
Charente, p. 652, 1844.
-
Pérucaud 1904 : Pérucaud (abbé) (J. B.) — souterrain,
commune de Brigueuil, lieu dit Anglard, BSAHC, annexe III,
1904-1905.
-
Piboule 1978 : Piboule (Patrick) — souterrain, commune de
Bouex, lieu dit Couradeau, Archéologie Médiévale, Les
souterrains aménagés de la France, p. 127, 1978.
-
Piveteau 1958 : Piveteau — souterrain, commune de Bouex,
lieu dit Mére, BSAHC, Inventaire Archéologique de la Charente
Gallo-romaine, 1958.
-
Proust 1984 : Proust (Raymond) — souterrain, commune de
Lesterps, lieu dit Bourg, BSAHC, N° 3, 1984, séance du
10/10/1984.
-
Proust 1984 : Proust (Raymond) — souterrain, commune de La
Magdeleine, lieu dit Bourg, BSAHC, N° 2, 1984, 2 éme trimestre.
-
Proust 1984 : Proust (Raymond) — souterrain, commune de
Ruffec, lieu dit Nouziéres, BSAHC, 1984.
-
Proust 1984 : Proust (Raymond) — souterrain, commune de
Saint Front, lieu dit Bourg, BSAHC, N° 3, 1984, séance du
10/10/1984.
-
Proust 1984 : Proust (Raymond) — souterrain, commune de
Saint Laurent de Ceris, lieu dit Bourg, BSAHC, N° 3, 1984.
-
Rey 1936 : Rey (L.) — souterrain, commune de Saint Yrieix,
lieu dit Mesniers, SAHC, 1936.
-
Rey 1942 : Rey (L.) — souterrain, commune de Angoulême,
lieu dit rue Aguesseau, BSAHC, 1942, séance du 09/12/1942.
-
Ridouin 1980 : Ridouin (Guy) — souterrain, commune de
Barbezieux, lieu dit centre des Impôts, Subterranéa, N° 35,
1980.
-
Ridouin 1987 : Ridouin (Guy) — souterrain, commune de
Roullet St Estéphe, lieu dit Moreaux, Subterranéa, N° 61, 1987.
-
Rivières 1966 : Rivières — souterrain, commune de
Roussines, lieu dit camp de la Motte, BSAHC, 1966, séance du
10/03/1966.
-
Roger 1999 : Roger (Guy) — souterrain+silo, commune de
Chadurie, lieu dit Berche, Subterranéa, N° 112, p. 98, 1999.
-
Roger 1999 : Roger (Guy) — souterrain+silos, commune de
Dirac, lieu dit Bois de la Pue, Subterranéa, N° 110, p.55, 1999.
-
Roger 1999 : Roger (Guy) — silos, commune de
Villebois-Lavalette, lieu dit Sénéchal, Subterranéa, N° 112, p.
111, 1999.
-
Roger 1999 : Roger (Guy) — souterrain-refuge, commune de
Villebois-Lavalette, lieu dit Fontignoux, Subterranéa, N° 112,
p. 111, 1999.
-
Roger 1999 : Roger (Guy) — souterrain-refuge, commune
d’Edon, lieu dit Grande Crête, Subterranéa, N° 110, p.55, 1999.
-
Roger 2000 : Roger (Guy) — souterrain+silos, commune de
Dirac, lieu dit Baloge, Subterranéa, N° 114, p. 35, 2000.
-
Roger 2000 : Roger (Guy) — souterrain+silo, commune de
Garat, lieu dit Chément, BSAHC, p. 213, 2000.
-
Roger 2000 : Roger (Guy) — silos, commune d’ Edon, lieu
dit Gélie, BSAHC, p.202, 2000.
-
Roger 2000 : Roger (Guy) — silo, commune de Torsac, lieu
dit Trautran, Sondage, rapport SRA ref. site 16 382 19 AH,
programme H20.
-
Roger 2000 : Roger (Guy) — souterrain, commune de Edon,
lieu dit Mesnieux, Subterranéa, N° 114, p.51, 2000.
-
Roger 2001 : Roger (Guy) — souterrain, commune de Dirac,
lieu dit Courasses, Sondage, rapport SRA ref. 16 119 10 AH,
programme H20.
-
Rollet 1961 : Rollet (Jacques) — souterrain-refuge,
commune de La Couronne, lieu dit Gallands, BSAHC, 1961, séance
du 04/05/1961.
-
Rollet 1962 : Rollet (Jacques) — silo, commune de Brie-Bardenac,
lieu dit Coiron, BSAHC, 1962-1963, séance du 12/04/1962.
-
Rollet 1963 : Rollet (Jacques) — souterrain, commune de
Saint Mary, lieu dit Champ de la Perdrix, BSAHC, p. 50, 1963,
séance du 12/04/1962.
-
Rollet 1968 : Rollet (Jacques) — souterrain construit,
commune de Courgeac, lieu dit Breuilh, BSAHC, Communications sur
les pigeonniers Charentais, 1968, séance du 09/05/1968.
-
Sauteraud 1927 : Sauteraud (Yves) — souterrain, commune de
Villefagnan, lieu dit Cendrilles, BSAHC, annexe V, 1927, séance
du 13/07/1927.
-
Serbuisson 1969 : Serbuisson — souterrain, commune de
Champniers, lieu dit Blancheteauds, SAHC, 1969, séance du
12/06/1969.
-
Simonnaud 1967 : Simonnaud — souterrain, commune de
Lupsault, lieu dit Eglise, BSAHC, 1967, séance du 11/05/1967.
-
Touzaud 1903 : Touzaud — souterrain, commune de Courcome,
lieu dit Magné, BSAHC, 1903, séance du 08/04/1903.
-
Vernou 1984 : Vernou (Christian) — souterrain-refuge,
commune de Gente, lieu dit Bourg, Bulletin de liaison et
d'information de la Direction Régionale des Antiquités Historiques,
N° 13, pp. 12-14, fig. 2, 1984.
-
Vernou 1984 : Vernou (Christian) — souterrain-refuge,
commune de Salle d'Angles, lieu dit Broute Chèvre, GREH, N° 6,
1984.
-
En préparation
-
Roger : Roger (Guy) — souterrain, commune de Magnac sur
Touvre, lieu dit Ecoles — abri de falaise, commune de Sers, lieu
dit Roche — abri de falaise, commune de Sers, lieu dit Coussadeaux
— abri de falaise, commune de Sers, lieu dit Bellevau — abri de
falaise, commune de Sers, lieu dit Nadaud — souterrain+silos,
commune de Vouzan, lieu dit Pendants. Tous études en cours.
Synthèse de Bibliographie
Les anciens travaux dans ce domaine sont tous de valeur inégale,
présentant des disparités et souvent incomplets, mais ils présentent
néanmoins l’intérêt de fournir des éléments convergents dignes
d’intérêt. Le dépouillement de la bibliographie disponible sur le
département de la Charente, démontre qu'aucune publication sérieuse n'a
été faite avant 1920 (voir graphique ci-dessous)
Il est à signaler qu'en Charente, à notre connaissance dans le programme
H20 "espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques
gallo-romaine, médiévale et moderne", aucun silo à grains, souterrain
aménagé, habitat de falaise ou abri troglodytique, ainsi que leurs
environnements, n'a fait l'objet de fouilles de sauvetage ou de fouilles
programmées.
Il serait souhaitable dans un avenir très proche et tant que la mémoire
humaine des anciens est encore présente de pouvoir établir un inventaire
des souterrains de la Charente. En fonction des sources disponibles
(Société Archéologique, Association Archéologique, Groupement
Spéléologique, Individuel, etc.), il semble raisonnable de pouvoir
avancer le chiffre de 400 à 500 sites pour l'ensemble du département.
Tableau représentant les
décennies où ont été faites des déclarations de
découvertes de sites souterrains
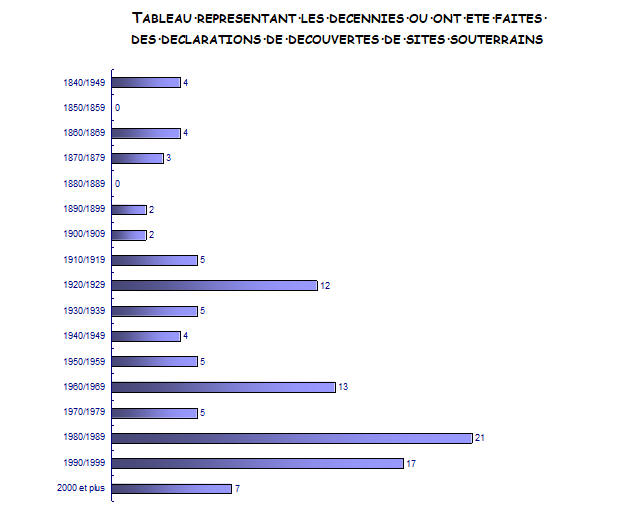
Logiciels utilisés
-
Traitement de texte Word
-
Traitement base de données et
graphique Excel
-
Traitement image Photoshop
5.5.
-
Traitement des cartes Bayo
Carto Explorateur (Charente Nord et Sud).
-
Traitement des coordonnées
Lambert Bayo Carto Navigation.
-
Traitement des plans Ocad
(version freeware).
-
Traitement des élévations en 3
D Surfer (version freeware).
Texte - Conception - Réalisation
Guy Roger Mars 2005
Récapitulation des notes
Commune
de Combiers. Note de Véronique Dujardin BSAHC, 1999, N° 3, p.
235. (Ndla).
Ces
calcaires ont été recouverts par un islandis pendant des
centaines d’années. Nous savons que le gel pénètre dans le
sous-sol de plus en plus profondément au prorata du temps
écoulé. En conséquence, nous pouvons supposer que l’action du
gel a atteint des épaisseurs de plusieurs mètres. Si son
installation n’a que peu d’impact sur le substratum calcaire,
par contre, lors du dégel ses effets dynamiques sont
remarquables. C’est ce que l’on appelle la cryoturbation (Serge
Desthomas).
Le
souterrain du logis de la Cour à Moulidards, se développe sur
une longueur de 94 mètres (Ndla).
Debord
(A.) – La Société Laïque dans les pays de la Charente au Xe
et XIIe siècles, Essai de localisation des
anciennes forêts, Picard, 1984, Paris, p. 49-55.
Chapelot
(J.) & Fossier (R.) – Le village et la maison au Moyen Age,
Hachette, Paris, 1980, page 116.
Le
mot latin Sirus, n’est plus traduit aujourd’hui. On retrouve sa
trace dans (Dictionarium Universale Latino-gallicum, Parisis,
MDCCLXXXVI.), sous le terme Siros et Syrus (Ndla).
Les
phases d’occupation n’ont pas été établies en fonction d’une
chronologie d’occupation, mais en suivant une chronologie de
creusement (Ndla).
Nous
n’entrerons pas dans une description bibliographique complète
qui traite de ces structures, mais nous citerons néanmoins :
Diodore de Sicile et Pline l’Ancien qui cite Varron, lequel
indique que le blé dur et le millet pouvaient être conservés de
50 à 100 ans. D’autres auteurs font référence à l’emploi des
silos souterrains durant l’Antiquité – Hérodote – Xénophon –
Aristote – Démosthène, au Moyen–Age : Comet –Adrian – Drapon,
parlent de la conservation souterraine de l’avoine… (sources
Gast M. & Sigaut F. - Les techniques de conservation des
grains à long terme, Paris, CNRS, 1981). (Ndla).
L’asymétrie
des parois, les irrégularités du creusement n’autorisent pas un
calcul rigoureux quant à leur volume. A défaut de pouvoir en
mesurer leur contenance exacte nous avons utilisé une approche
mathématique en assimilant sa forme à celle d’un tonneau et en
employant alors la formule traditionnelle du calcul de son
volume. Avec cette formulation, la marge d’erreur pourrait être
inférieure à 10% (Ndla).
|



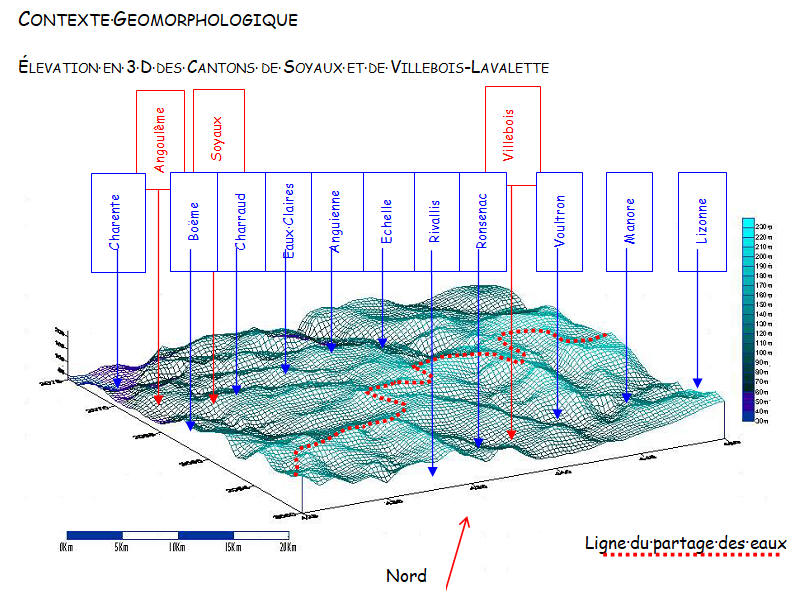
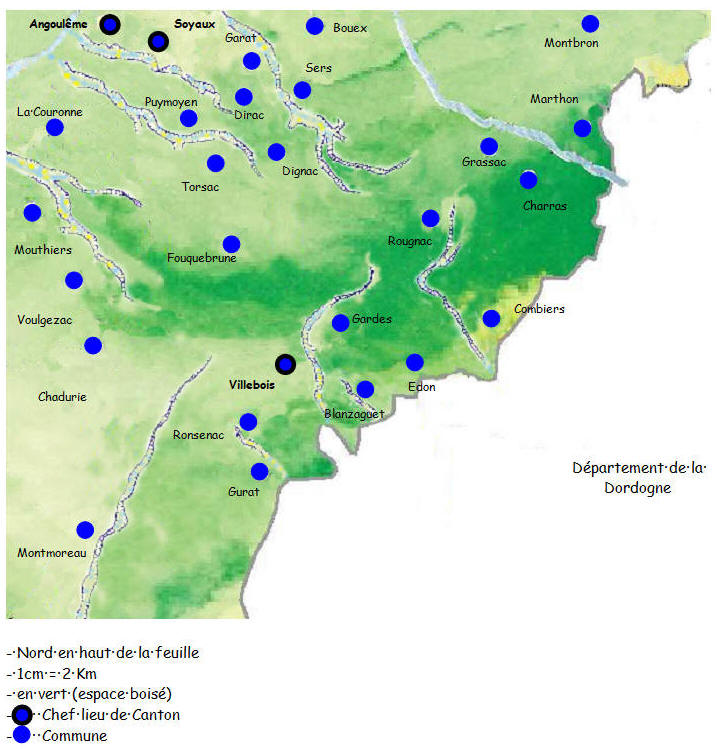
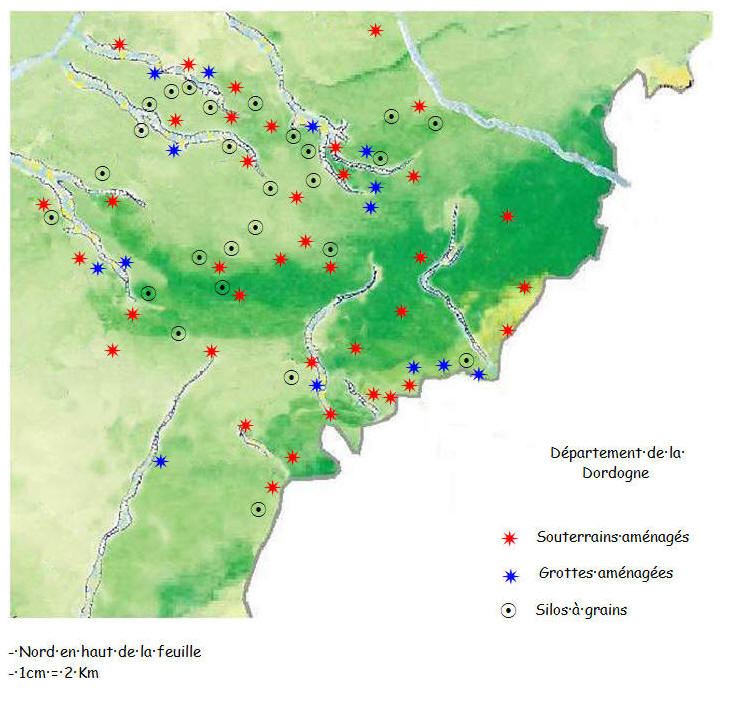
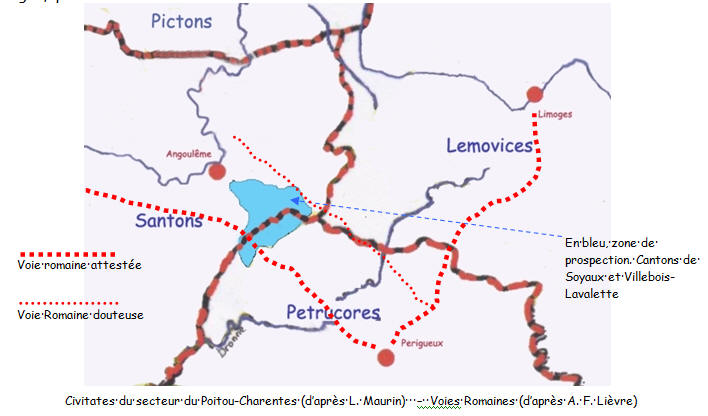
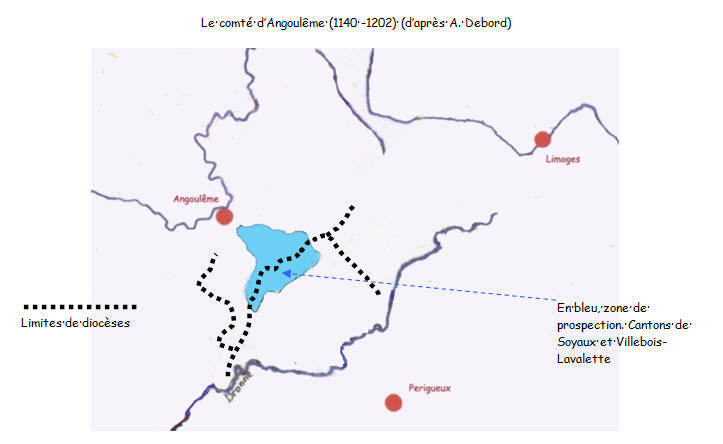
 75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.
75% de ces sites se situent en zone rurale et 25% en zone urbaine.



 Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce
cas elle ne porte plus que sur 21% des sites.
Une deuxième phase de réemploi a été également observée, mais dans ce
cas elle ne porte plus que sur 21% des sites. 

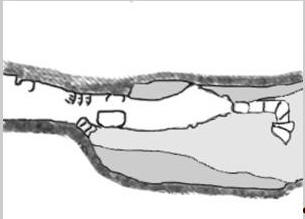
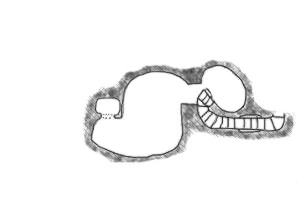

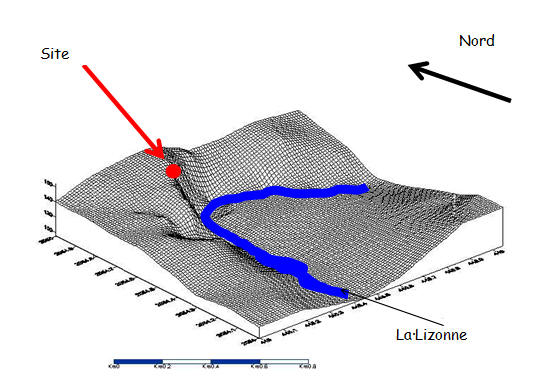
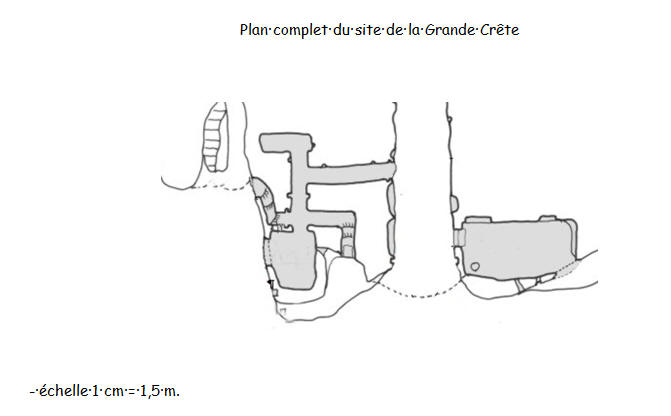

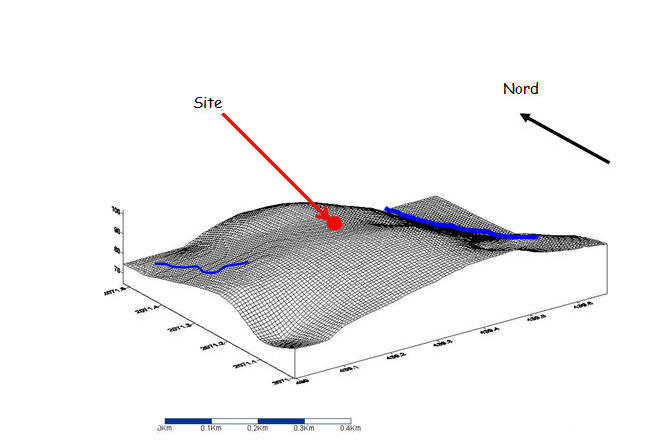
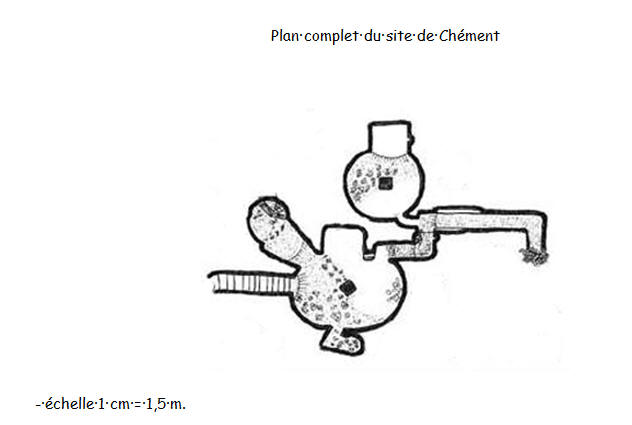
.jpg)